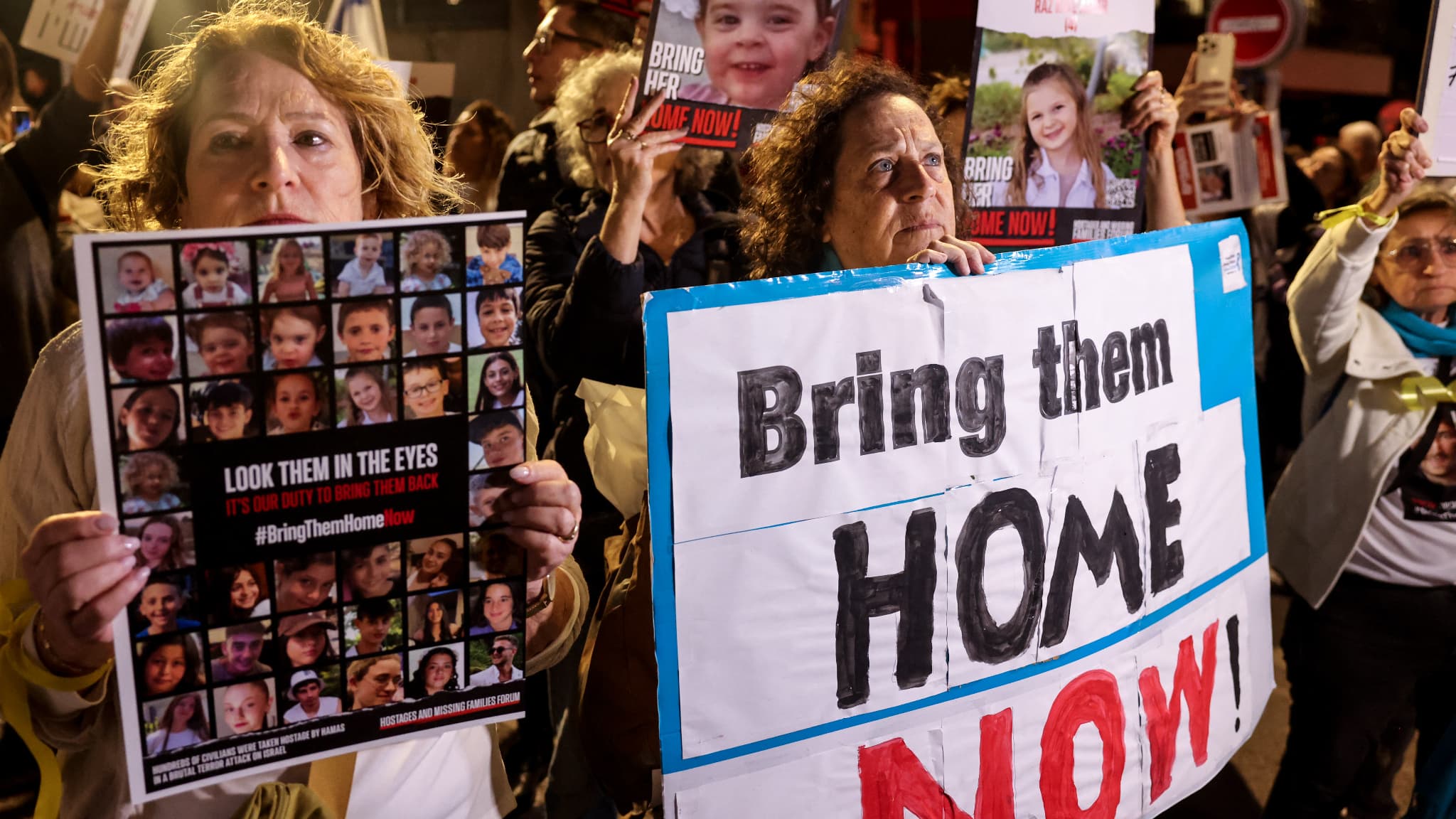- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
Les livres, films, expositions concernant la fin de la Première Guerre mondiale sont légion en cet automne 1918. Mais qui évoquera un fléau oublié qui s’est produit voilà tout juste un
siècle ? Au printemps 1918, en Amérique, en Chine et en Europe, une maladie étrange, d’abord assez bénigne, cloua des milliers de personnes au lit, puis, en quelques mois, d’octobre 1918 au
début de 1919, des millions de soldats et de civils furent emportés par la grippe espagnole. L’humanité n’avait rien connu de comparable depuis la grande peste noire, au quatorzième siècle.
Certains observateurs craignaient de voir approcher la fin de la civilisation. Nous savons aujourd’hui que cette épidémie a été la plus meurtrière de l’histoire et qu’ayant tué entre
quarante et cinquante millions de personnes à travers le monde (certaines estimations vont jusqu’à cent millions), la grippe espagnole a été l’une des pires catastrophes du XXe siècle. En
comparaison, les pertes humaines de la Première Guerre mondiale sont estimées à environ 18 millions de morts et celles de la Seconde à 60 millions. Serait-ce parce que la grippe a provoqué
moins de décès en Europe que dans d’autres parties du monde que nous avons oublié ce fléau majeur ? AUX SOURCES DE NOTRE PRÉSENT Dans _La grande Tueuse_ (Albin Michel, 2018), Laura Spinney
montre à quel point cette pandémie reste mystérieuse. Nous ignorons d’où elle est venue (à coup sûr, pas d’Espagne, ce pays neutre dont la presse fut simplement la première à évoquer la
maladie), pourquoi elle s’est répandue si vite et comment elle a disparu. Son influence a été considérable : elle a redessiné les contours de la population mondiale, hâté la conclusion de la
Grande Guerre et peut-être contribué au déclenchement de la Seconde. Elle a probablement précipité l’Inde vers l’indépendance (l’épidémie aurait exacerbé les tensions entre la population et
les colons britanniques, conduisant notamment au massacre d’Amritsar, en avril 1919. Voir A.J.P. Taylor, _English History 1914-1945_, Oxford U.P., 1965, pp.152-3) et a dynamisé la recherche
d’un système de santé universel et de médecines alternatives (l’une des conséquences de la pandémie fut que, dans les années 1920, nombre de pays créèrent ou réorganisèrent leurs autorités
sanitaires, et la Ligue des Nations créa sa propre organisation pour la santé, ancêtre de l’actuelle O.M.S. Sur les nouvelles recherches, voir Claude Hannoun, _La Grippe, ennemie intime_,
Balland, 2009, chapitre 4). Ce virus, qui s’est transmis si aisément à presque tous les endroits de la planète, a contribué de manière décisive à la formation du monde contemporain.
Pourtant, le plus grand catalogue de bibliothèque du monde, WorldCat, recense aujourd’hui 80 000 livres sur la Première Guerre mondiale (en plus de 40 langues) et seulement 400 sur la grippe
espagnole. Étrangement, nous la traitons comme un détail surgi à la fin de la Grande Guerre. Il est difficile de dire quels pays s’y sont le plus intéressés, mais il est certain que les
États-Unis ont été un acteur important, pour les recherches comme pour la fiction (Charles de Paolo, _Pandemic Influenza in Fiction, a Critical Study_, Jefferson, North Carolina, McFarland
& Company, Inc., 2014). FIGURATION DU MAL Spinney avance une explication à cette étrange amnésie : la difficulté de représenter une pandémie. Une guerre a un vainqueur qui imposera sa
version des faits à la postérité, alors que dans le cadre d’une épidémie, il n’y a que des vaincus. Ni l’art ni la littérature ne s’y sont vraiment intéressés bien qu’elle ait influencé leur
histoire. _Le Cri_ d’Edvard Munch a peut-être été inspiré par l’état d’abattement dans lequel il se trouvait après avoir contracté la maladie ; elle a tué le peintre Egon Schiele et Arthur
Conan Doyle cessa d’écrire des fictions après avoir perdu son fils, victime de la grippe. Guillaume Apollinaire et Edmond Rostand succombèrent à cette maladie, qui frappa ainsi les deux
pôles de la scène littéraire française, l’avant-garde et la tradition pompière. De quoi justifier les propos de Virginia Woolf se demandant en 1925 dans son court essai _On Being Ill_ (_De
la maladie_) pourquoi la littérature n’explorait pas davantage le riche domaine de la maladie. Dans mon roman consacré à ce fléau, _La Guerre insaisissable_ (J.C. Lattès, 2018), je me suis
interrogé sur cet oubli, car quoi de plus passionnant, au fond, que le récit des luttes grandioses et mystérieusement oubliées de notre histoire ? Cela supposait d’avancer des hypothèses sur
les origines de la pandémie, non pas afin de distordre les fait historiques à la Dumas, mais pour retrouver ce passé perdu. Il s’agissait d’évoquer la stupeur des hommes de 1918 devant ce
mal foudroyant, leur effroi sacré devant cette nouveauté, le virus, un microbe totalement invisible qu’aucun microscope ne pouvait traquer, et le courage de ceux qui tentèrent en vain de
comprendre et de soigner. C’est l’une des voies romanesques possibles aujourd’hui, explorer les énigmes du passé et leur puissance intacte de suggestion, raviver une flamme plutôt que
vénérer des cendres. Désormais, la question à se poser est moins comment cette pandémie est-elle née que quand reviendra-t-elle ? Non parce que le virus, identifié comme « H1N1 », a été
reconstitué et qu’il est maintenu à l’abri dans quelques laboratoires hautement sécurisés. Quoique. Mais plutôt parce qu’en ces temps de circulations mondialisées, beaucoup d’experts
estiment qu’une nouvelle pandémie globale est inévitable et qu’il y a de fortes probabilités que ce soit une grippe, « espagnole » ou pas. Commémorons donc la fin de la Grande Guerre, mais
en gardant à l’esprit la devise des bactériologistes du début du XXe siècle : la guerre est un incident que l’homme introduit bêtement au milieu du combat, autrement plus meurtrier, qu’il
mène depuis toujours contre les microbes.