
- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
Le TDPM est une maladie relativement récente, ayant été reconnu en 2013. Encore aujourd’hui, 12 ans plus tard, les diagnostics sont assurément plus rares que l’ensemble des cas réels,
explique le Pr Jean-François Lepage, en raison d’une méconnaissance de ce trouble chez les femmes et les médecins. «Contrairement au syndrome prémenstruel, ce trouble va venir créer des
impacts importants sur le fonctionnement. Les femmes qui en sont touchées vont avoir de la difficulté à vivre leur vie normale. C’est incapacitant», indique celui qui se spécialise en
neuropédiatrie à l’UdeS. On estime qu’entre 4 % et 8 % des femmes vivraient avec ce trouble, ce qui représente «des dizaines de milliers» d’entre elles au Québec. Dépression sévère,
irritabilité intense, anxiété et même pensées suicidaires: la liste des symptômes du TDPM est large et inquiétante, relève le Pr Lepage. Ces manifestations sont récurrentes d’un mois à
l’autre, ce qui veut dire que les femmes vivant avec le TDPM les vivent chaque mois à l’approche de leurs menstruations. > «La communauté médicale ne prend peut-être pas assez au sérieux
> l’ensemble des symptômes rapportés par la femme. On lui dit > “fais avec ça, ma grande, c’est ça la vie d’une femme”.» > — Jean-François Lepage, professeur à l'UdeS De ce
fait, les traitements actuels sont peu efficaces et certains ont des effets secondaires sur les femmes. On peut par exemple les mettre sous un régime d’antidépresseurs en permanence, pour
une condition qui ne dure que quelques jours par mois. TRAITEMENT ESPÉRÉ C’est avec ce constat en tête que le Pr Lepage a choisi de s’intéresser à comment utiliser la technologie existante
et éprouvée pour tenter de s’attaquer au TDPM. Son hypothèse? Que la stimulation magnétique transcrânienne peut aider les femmes qui conjuguent avec ce trouble. «C’est comme une grosse
cuillère dans laquelle passe un courant électrique. Ça vient créer un champ magnétique qu’on va apposer sur la tête pour stimuler le cerveau de façon non intrusive et non douloureuse»,
vulgarise-t-il. «Pourquoi a-t-on pensé à faire ça? Certains symptômes du TDPM recoupent fortement les symptômes de la dépression majeure. Ce traitement est reconnu comme étant efficace
contre la dépression majeure. On veut donc transposer ces acquis au TDPM», ajoute le Pr Lepage. Le projet de recherche qu’il mène à cet effet est financé par la Fondation pour la recherche
pédiatrique et des chercheurs de l’Université de Montréal y participent également. Le déroulement est fort simple. La vingtaine de participantes, toutes des adolescentes atteintes du TDPM,
passent une première imagerie par résonance magnétique (IRM). On leur administre par la suite le traitement avant de leur faire passer une deuxième IRM pour observer les changements. Il
s’agit de la première phase de l’étude. Si elle est concluante, des enquêtes similaires, mais à plus grand déploiement seront réalisées pour valider et, au besoin, nuancer les premiers
constats. «Le but de faire cette recherche, c’est vraiment d’arriver à des applications cliniques», donc à permettre à ce traitement d’être homologué contre le TDPM, assure Jean-François
Lepage. Les premiers résultats de l’étude devraient être connus d’ici cet automne, note-t-il, alors que les tests cliniques se dérouleront jusqu’à cet été.

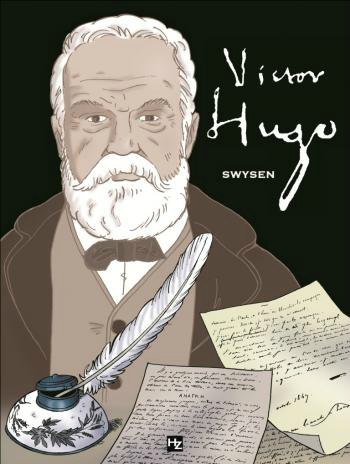

![[info va] le livreur deliveroo algérien qui refusait de “servir les juifs” a été arrêté et va être expulsé](https://www.valeursactuelles.com/assets/uploads/2021/01/SIPA_00866440_000042-scaled.jpg)




