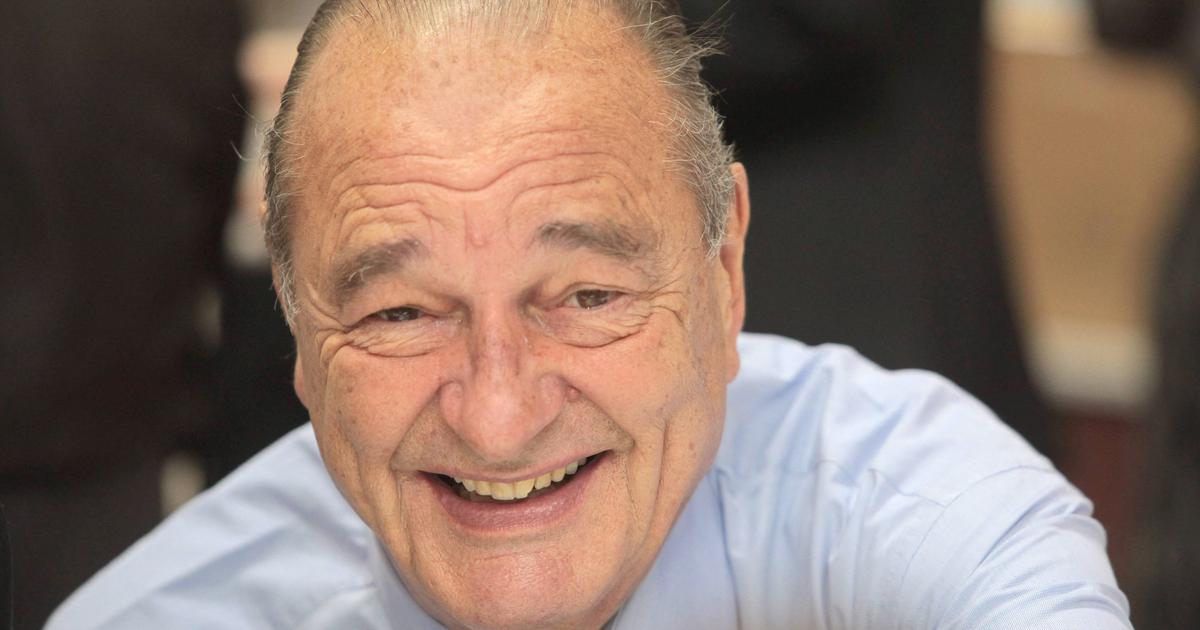- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
Alors que les Etats-Unis ont annoncé mardi de nouvelles mesures financières contre le secteur énergétique iranien, Téhéran a dénoncé un acte « _hostile_ », mercredi 23 avril, à quelques
jours de la reprise des discussions sur le nucléaire. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, « _a considéré [que] la politique américaine
d’imposition de sanctions [contre l’Iran était] un signe clair de l’approche hostile_ » de Washington, jugeant que l’imposition de ces sanctions « _é[tait] en contradiction claire avec la
revendication d’ouverture aux négociations de la part des Etats-Unis et indiqu[ait] le manque de bonne volonté et de sérieux des Américains_ ». La veille, le Trésor américain avait accusé
les entreprises iraniennes visées par de nouvelles sanctions d’avoir « _financé les programmes nucléaires et d’armes conventionnelles avancées de l’Iran_ » ainsi que des groupes
pro-iraniens, les houthistes yéménites et le Hamas palestinien. Alors que l’Iran et les Etats-Unis doivent se retrouver samedi, à Oman, pour une troisième session de pourparlers indirects
sur le dossier nucléaire iranien, le climat entre les deux parties reste tendu. En toile de fond, le président états-unien, Donald Trump, continue de proférer des menaces contre Téhéran. Les
frappes contre le Yémen, et la menace d’une invasion terrestre, s’inscrivent également dans le cadre de la stratégie de pression maximale adoptée par Trump pour amener l’Iran à la table des
négociations. Dans ce contexte, de nombreux analystes estiment que les chances d’un accord sont minces. Les Etats-Unis multiplient les signaux contradictoires. L’envoyé états-unien pour le
Moyen-Orient, Steve Witkoff, a souligné que l’accord devrait être « l’accord de Trump », prenant ses distances avec l’accord nucléaire conclu en 2015 par Obama. La semaine dernière, Witkoff
avait déclaré que l’Iran pourrait maintenir un programme d’enrichissement de l’uranium à hauteur de 3,67%, avant de faire marche arrière et d’expliquer que l’objectif des Etats-Unis était
d’éliminer complètement la capacité de l’Iran à enrichir de l’uranium. La diplomatie de l’administration Trump avec l’Iran va en réalité bien au-delà de la non-prolifération nucléaire.
Quelle que soit leur issue, les négociations auront des implications massives pour Téhéran à un moment où le régime fait face à une transition de leadership cruciale et remodèleront le
Moyen-Orient avec des répercussions dans toute l’Eurasie. Ces volte-faces n’en témoignent pas moins des tensions stratégiques plus profondes qui traversent la Maison Blanche. Alors que
certains secteurs au sein de l’administration Trump, Rubio et Waltz en tête exigent un démantèlement complet, la défense d’un compromis, notamment par Vance, Hegesth et Witkoff selon un
rapport d’_Axios_, bute sur un demi-siècle d’hostilité entre les deux pays. Dans ce contexte, l’option militaire reste sur la table. La semaine dernière, le _New York Times_ révélait que
l’administration étasunienne avait débouté le régime israélien après que celui-ci ait mis sur pied des plans détaillés pour un assaut militaire contre les installations nucléaire iraniennes,
un plan qui nécessitait le soutien des Etats-Unis. Mais le _Times_ confirmait également que l’armée états-unienne avait déployé ces dernières semaines une flotte de bombardiers B-2 dans la
région, les seuls bombardiers capables de transporter les bombes nécessaires pour détruire les infrastructures iraniennes, construites en profondeur. La réalité est que l’impérialisme
états-unien, tant sous les présidents démocrates que républicains, après avoir été directement impliqué dans la construction du programme nucléaire de l’Iran [1], se prépare depuis des
années à une guerre de changement de régime en Iran. Les préparatifs en ce sens se sont considérablement intensifiés au cours des dix-huit derniers mois, tandis que les Etats-Unis, sous la
direction de Biden puis de Trump, ont apporté un soutien sans faille au génocide perpétré par Israël à l’encontre des Palestiniens. Il n’en reste pas moins que cette option va à l’encontre
de l’objectif déclaré de Trump d’éviter une régionalisation de la guerre au Moyen-Orient. Et que dans un contexte de transformation profonde de l’économie internationale et de conflictualité
grandissante avec la Chine, Washington ne semble pas vouloir à nouveau être aspiré par le Moyen-Orient. Eviter la guerre est sans doute plus crucial encore pour l’Iran. La République
islamique traverse sa pire crise depuis 1979. Sa politique régionale est très sérieusement affaiblie par la situation critique du Hamas, l’affaiblissement du Hezbollah, la chute d’al-Assad
en Syrie, et alors que les Houthis, déjà ciblés par les frappes étasuniennes, pourraient très prochainement avoir à affronter une opération terrestre menée par les Emirats et l’Arabie
saoudite. Son économie est également en ruine et la désaffection de la population n’a jamais été aussi forte. Le régime iranien, de plus en plus dysfonctionnel, et assis sur une poudrière
sociale, alors que les tensions sociales ont été intensifiées par l’impact dévastateur des sanctions occidentales [2], pourrait en outre faire face au retour de la contestation sociale. Le
règne du Guide suprême (l’ayatollah Ali Khamenei au pouvoir depuis trente-six ans aura 86 ans ce mois-ci) se rapproche de sa fin. Comme le note Kamran Bokhari dans les colonnes de
Geopolitical Futures : « _Une fois que Khamenei sera hors-jeu, l’armée – elle-même divisée entre le Corps idéologique des gardiens de la révolution islamique et les Artesh (forces armées
régulières) plus professionnelles – remplacera probablement le clergé en tant que noyau dur du régime. Un arrangement pour le moins fragile. Plus important encore, Téhéran doit éviter que la
mort de Khamenei ne devienne un point de ralliement pour un soulèvement populaire, alors que le pays passe à un nouvel accord difficile de partage du pouvoir. Ainsi, l’Iran a besoin d’un
peu de répit des sanctions afin d’améliorer sa situation économique et politique intérieure avant le début de la crise de succession_ ». Ces dernières années, dans ce cadre, les luttes
intestines au régime réactionnaire et théocratique iranien se sont approfondies entre une fraction « modérée » ou « réformatrice » cherchant un rapprochement avec les Etats-Unis et les
puissances impérialistes européennes, et une fraction « dure » engagée dans un alignement étroit avec la Chine et la Russie. Le fait que les partisans de la ligne dure traditionnelle aient
tacitement approuvé les pourparlers avec les Etats-Unis témoigne de l’ampleur des crises régionales et intérieures auxquelles est confronté le régime iranien. Mais dans le même temps,
Téhéran a continué à rechercher des relations plus étroites avec la Russie, livrant au Kremlin des drones dans le cadre de la guerre en Ukraine, et la Chine, et a tenu des discussions
séparées avec les deux puissances sur son programme nucléaire. Washington est divisé sur la nature de l’accord à proposer, mais la discorde au sein du régime iranien est bien pire. La
situation à laquelle il est confronté pourrait faciliter la concrétisation d’un accord. Mais sa fragilisation interne et son instabilité grandissante augmentent également le risque d’un
échec. Celui-ci conduirait probablement à la guerre. En réalité, même la perspective d’un accord n’écarterait pas totalement la possibilité d’une guerre régionale. Alors que les fronts et
les conflits internationaux sont de plus en connectés, la capitulation de Téhéran face aux exigences des Etats-Unis aggraverait les conflits entre Washington, d’une part, et la Russie et la
Chine, d’autre part, ouvrant la voie à des affrontements plus directs. Le seul moyen de sortir de cette situation dangereuse est la mobilisation autonome des masses iraniennes en lien avec
les classes populaires de l’ensemble de la région pour dégager l’impérialisme de la région et les régimes théocratiques qui les gouvernent. Dans le contexte du génocide des Palestiniens qui
se poursuit, cette nécessité est plus que jamais vitale.