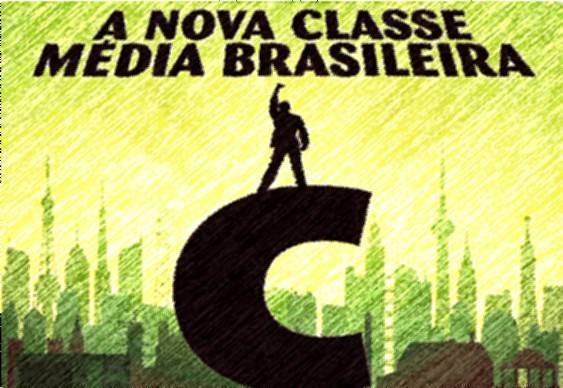- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
ENTRETIEN AVEC PASCAL CRITTIN Le 4 mars, les Suisses vont décider lors d’une votation de l’avenir de l’audiovisuel public suisse. Analyse par Pascal Crittin directeur de la RTS (Radio
Télévision Suisse francophone). propos recueillis par Pauline Porro Publié le 26 février 2018 Que disent les derniers sondages sur l'issue de la votation ? Pascal Crittin : Les trois
derniers sondages parus ces dernières semaines montrent plutôt une tendance vers le « non », vers le refus de l‘initiative, de l'ordre de 60 % contre 40 %. Nous attendons encore un
sondage commandé par la SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) pour la semaine prochaine, et nous saurons si la tendance est toujours la même. Il reste encore deux semaines de
campagne et c'est la dernière ligne droite qui est importante. Quels que soient les sondages, c’est le vote des citoyens le 4 mars qui compte. Est-ce que certains publics se sont
davantage prononcés en faveur du maintien ou de la suppression de la redevance ? Pascal Crittin : Non, le dernier sondage qui a été fait par le groupe Tamédia, un des deux grands groupes de
presse de Suisse, indique que toutes les régions linguistiques de Suisse refuseraient l'initiative. C’est plus net pour la Suisse romande, puis vient la Suisse alémanique, qui rejette
l’initiative à hauteur de 59 % et ensuite la Suisse italienne, qui la refuse à une courte majorité. Mais il faut prendre en compte que le canton du Tessin est petit, et qu’il y a donc une
certaine marge d'erreur dans le sondage. Par ailleurs, il semblerait que toutes les classes d'âge refusent l'initiative, y compris les jeunes. En fait, nous ne sommes pas
devant une fracture générationnelle, mais une fracture idéologique. Deux visions du monde complètement opposées : d’un côté la foi dans le marché et de l’autre, le service public. Encore une
fois ce n’est qu‘un sondage. En Suisse, nous votons quatre fois par an, avec souvent plusieurs objets par votation. En conséquence, la plupart du temps, les campagnes se déroulent sur un
temps très court, environ deux mois. Ce qui signifie qu’il reste encore pratiquement l'équivalent d'une demi-campagne. Donc, les opinions peuvent se consolider ou évoluer
d'ici là. Est-ce qu'il y a déjà eu des offensives de cette ampleur contre la SSR ? Et si non, pourquoi maintenant ? Pascal Crittin : Il n'y a jamais eu d'initiative de
cette ampleur, puisqu’il s‘agit ni plus ni moins d'interdire tout financement public de l‘audiovisuel. Et sans redevance ou impôt, il n'y a plus de service public audiovisuel. Il
s’agit d‘une question de vie ou de mort, c'est très radical comme proposition. En revanche, il existe depuis plusieurs années un débat assez intense sur le service public audiovisuel, à
savoir sur son périmètre et sa coexistence à côté des médias privés et de la presse en particulier, qui connait chez nous, comme ailleurs, une grave crise. Je pense que cette initiative
survient aujourd’hui en raison de la conjonction de plusieurs facteurs. Le premier concerne l’évolution des médias. Une partie du public, plutôt jeune, ne regarde plus la télévision, et
n'écoute plus la radio. Nous sommes pourtant très engagés dans les médias digitaux, numériques. Mais une partie du public qui nous « consomme » sur ces plateformes (et les jeunes en
particulier) ne crédite pas ces contenus au service public. À cela s’ajoute la concurrence des contenus gratuits sur les plateformes numériques, les plateformes globalisées, américaines mais
aussi européennes ou suisses. En conséquence, une partie du public se demande pourquoi payer, puisque finalement l'information est disponible gratuitement. Enfin certaines personnes ne
veulent payer que ce qu’elles consomment, ce qui revient à remettre en cause le principe de la solidarité inhérente à un service public. Pour vous, que doit être un service public
audiovisuel ? Pascal Crittin : > Dans les pays où les médias publics sont faibles, la démocratie > et le débat public sont plus faibles également C’est une question qui se pose
différemment selon la taille du pays. De façon générale, je pense que nous avons besoin de garantir l'accès de tous à une information de qualité dans tous les domaines, et ce surtout à
l'heure de la globalisation de l'information et du phénomène des fake news. Je ne dis pas que les médias privés produisent de la mauvaise qualité. J'observe simplement que
dans les pays où les médias publics sont faibles, la démocratie et le débat public sont plus faibles également. Vous pensez à quels pays par exemple ? Pascal Crittin : C'est l’Union
européenne de radio-télévision qui a formulé cette observation, ainsi que l’institut Reuters d’Oxford et plusieurs études européennes. Voyez les États-Unis où le service public est
extrêmement marginal. À l’inverse, partout où le service public est fort, les pays scandinaves par exemple ou la Suisse, la culture politique du public est plus forte. On peut prendre
également l’exemple de la Pologne, où le gouvernement est en train d'essayer de réguler le service public ou la Hongrie, où le débat démocratique n‘est peut-être pas des plus vigoureux
actuellement. En Suisse, la problématique est encore plus complexe car c’est un petit pays divisé en quatre régions linguistiques. Or, l’audiovisuel est un produit culturel qui se développe
dans une entité culturelle donnée. On ne peut pas avoir un seul service public suisse, il est forcément suisse francophone, suisse italien et suisse allemand, etc. Donc, l’existence de ces
petites régions linguistiques a pour conséquence qu’en l’absence d’audiovisuel public, il y a une grande perte de qualité et de diversité médiatique, particulièrement dans les petites
régions. Que pensez-vous des débats qui ont lieu en France sur l'avenir de l'audiovisuel public ? Pascal Crittin : > Les décisions politiques prises dans les grands pays voisins
ont > toujours un écho en Suisse et influencent l'orientation du débat > dans notre pays Nous suivons cela avec intérêt et attention, car ce sont des questions très proches de
celles posées en Suisse, à savoir quel est le rôle du service public, quel est son périmètre, comment le financer, etc. Et puis nous sommes attentifs car ce qui se passe en France nous
influence, comme ce qui se passe en Allemagne influence la Suisse alémanique. Les décisions politiques prises dans les grands pays voisins ont toujours un écho en Suisse et influencent
ensuite l'orientation du débat dans notre pays. Donc en résumé, j'espère que l’on va garantir un audiovisuel fort en France. Par contre, sur la coexistence des médias publics avec
les médias privés, il y a là une réelle différence, parce qu'en France, vu la taille du marché, il y a de la place pour plusieurs grands acteurs contrairement à la Suisse. Pascal
Crittin : Oui. Les services publics en Suisse, sont très nombreux et de grande qualité sur l’ensemble du territoire : La Poste, les transports ferroviaires, la santé, la formation. Or il y a
de vrais débats justement sur ces services publics : est-ce normal de payer pour des primes d’assurances chères même si je suis en bonne santé, alors que d‘autres vont constamment chez le
médecin ? Ce sont des débats que l'on entend chaque année ici et je pense qu’il y a des domaines où la rentabilité n'est pas à l'avantage de tous. Il y a certains domaines,
qui, je crois, structurent la société dans une vision égalitaire, permettant à tout le monde d‘avoir le droit à toutes les prestations, à tout moment de sa vie. La rentabilité n'est pas
compatible avec ces domaines-là. Et je constate que dans le domaine de l'audiovisuel, la rentabilité, surtout en Suisse, ne permet pas d'avoir un audiovisuel assez fort. Une des
critiques adressée au service audiovisuel public suisse, est la diffusion de certains programmes, comme Game Of Thrones ou la Formule 1 par exemple. Est-ce que ce genre de programmes relève
du service public ? Quel doit en être le périmètre? Pascal Crittin : D’abord, nous sommes prêts à discuter du périmètre du service public. Évidemment, il y a des domaines de programmes qui
sont au cœur du service public : l’information, la culture, le sport d’une certaine manière aussi. Il y a certains sports ou certaines séries TV qui peuvent être plus à la périphérie du
service public. On peut en débattre. Maintenant, le fait est que derrière ces domaines de programmes, il y a du public. Aujourd'hui, le public a accès à ces offres moyennant la
redevance, qui va coûter l'année prochaine 1 franc suisse par ménage et par jour. Si demain, le public, pour avoir accès à ces offres doit payer beaucoup plus cher, je pense qu'on
ne rend pas service au public. Je ne dis pas que les médias privés ne peuvent pas diffuser eux-mêmes ce genre de programmes. Ce que je constate, c'est que le meilleur service qu'on
peut rendre au public, c'est de l'offrir dans un « bouquet » global, ce qui correspond aujourd'hui au service public. Vous expliquez en effet qu’en cas de suppression de la
redevance et donc si les consommateurs doivent s'adresser à des entreprises privées, ils devront payer plus cher leur abonnement télévisuel. Pourquoi ? Pascal Crittin : C'est ce
qu'il se passe dans le monde entier, et il n'y a pas de raison qu’il en soit autrement en Suisse. Aujourd'hui, nous avons un système solidaire, forfaitaire. L’année prochaine
tous les ménages en Suisse paieront la redevance à hauteur de 1 franc par jour et par ménage pour une soixantaine de chaînes de radios-télévisions, celles de la SSR ainsi que 34
radios-télévisions cantonales ou régionales qui font aussi du service public au niveau cantonal ou régional. Demain, si vous divisez l'offre de programmes en bouquets thématiques, vous
allez diviser le public en niches. Or, le fractionnement du public en plusieurs parts de gâteau a pour conséquence d’augmenter le coût de chacune de ces parts parce que vous perdez le
financement solidaire. Ceux qui s'intéressent à la culture aujourd'hui sont quelque part subventionnés par ceux qui s'intéressent à l'information. Demain, si je dois
produire la même offre culturelle qu'aujourd'hui, mais uniquement payée par ceux qui s'intéressent à la culture, puisque la culture n'est pas rentable et que je ne peux
donc escompter des revenus publicitaires, ces émissions seront hors de prix. Regardez ce qu'il se passe dans le domaine du sport : le sport en lui-même coûte déjà pratiquement le prix
de la redevance pour l’offre globale. Comment expliquez-vous le doublement du montant de la redevance en vingt ans ? Pascal Crittin : Nous avons un mandat donné par le gouvernement, que
l'on appelle la concession, l’équivalent du contrat d'objectifs en France. C'est donc le gouvernement qui décide si le service public couvre tel ou tel domaine, doit créer de
nouvelles chaînes, etc. Ce mandat s'est accru dans les années 1980-1990 et on a apporté le financement qui correspondait à la réalisation de ce mandat. Par ailleurs, en Suisse, le
service public fonctionne sur deux jambes : l'opérateur audiovisuel national public qui est la SSR, dont la RTS fait partie, et 34 radios-télévisions privées qui ont une mission de
service public au niveau cantonal ou régional. Il y a donc pour ainsi dire deux services publics en Suisse. C'est pour financer ces radios-télévisions privées que la redevance a
augmenté. À la SSR, nous n'avons pas eu d'augmentation de moyens depuis près de quinze ans. Par contre, le cahier des charges ne cesse d'augmenter parce qu'il faut se
développer sur les plateformes digitales pour atteindre le public là où il est, toucher davantage des jeunes, faire de l'audiodescription pour les sourds et malentendants, couvrir de
nouveaux domaines, etc. Donc, notre mandat augmente constamment, mais pas les ressources. Les partisans de la suppression de la redevance affirment que la liquidation pure et simple de la
SSR, n'est pas un scénario crédible et qu'elle pourrait s'autofinancer grâce aux abonnements et aux donations. Est-ce crédible ? Pascal Crittin : Les donations, je n'y
crois pas une seconde. Il n'y a pas de mécènes qui attendent que la SSR soit en péril pour pouvoir enfin y investir. La publicité est réellement en décroissance (elle ne concerne que la
télévision), donc, je ne vois pas comment elle pourrait soudainement croître simplement parce qu'on se privatiserait. Les abonnements sont toujours possibles, mais cela coûtera plus
cher pour moins d'offres dès lors qu'il n'y a plus le financement solidaire de la redevance. Autre chose : la RTS est financée à un tiers par les Alémaniques, en raison du
principe de solidarité. Les Suisses allemands paient un tiers de budget pour la radiotélévision des Romands alors qu'ils ne la regardent pas. Ce financement disparaîtrait avec les
abonnements et la logique du chacun pour soi. Est-ce que des entités de la SSR pourraient survivre à la suppression de la redevance ? En d’autres termes, à quoi ressemblerait le paysage
audiovisuel si le « oui » l‘emporte ? Pascal Crittin : > Voilà le paysage médiatique de « No Billag » : c'est tout le > soutien à la culture, au sport, à la musique, au cinéma
suisse > qui disparaît Il y a quatre entités dans la SSR (cinq si on compte Swissinfo, la plateforme numérique, qui vit à 100 % de financements publics): la SRF pour la Suisse alémanique,
la RTS pour la Suisse romande francophone, la RSI pour la Suisse italienne et la RTR pour la Suisse romanche. Dans cet idiome, qui est une des quatre langues nationales parlée par environ
40 000 personnes, nous produisons une radio et deux heures de télévision. Sans le financement public, c'est terminé. Impossible également de produire l’offre généraliste actuelle pour
la Suisse italienne, où vivent 400 000 personnes. Le marché suisse romand ne permet pas non plus de financer la RTS à lui tout seul, et je rappelle que les Suisses alémaniques apportent un
tiers du financement de la RTS. Le marché alémanique est plus grand et permet de produire quelques heures de radio et de télévision par jour, comme c’est le cas aujourd’hui à Zurich, un
marché de 2 millions d'habitants, de la taille de la Suisse romande. Actuellement, TeleZüri ne vit que de la publicité et elle produit moins de deux heures d'émissions par jour,
uniquement en allemand. Une partie d’entre elles sont des émissions de publireportages. Et elle ne soutient ni les musiciens suisses, ni le cinéma suisse ni le sport suisse comme le fait la
SSR. Voilà le paysage médiatique de « No Billag ». Quelques radios commerciales, là où il y a du marché, dans les villes disons, et puis l’une ou l’autre télévisions qui produisent au mieux
une heure ou deux heures de programme par jour. Et c'est tout le soutien à la culture, au sport, à la musique, au cinéma suisses qui disparaît. En cas de défaite de l’initiative, ne se
dirige-t-on pas inéluctablement vers une réforme en profondeur de la SSR? Et si tel est le cas, quelles sont les pistes de réflexion que vous menez au sein de la RTS et de la SSR ? Pascal
Crittin : Tout d’abord, si le peuple rejette l'initiative, c’est donc qu‘il apprécie ce que nous faisons et qu’il croit à la nécessité du service public. Mais effectivement, il y a des
choses qui vont changer. Dès l'année prochaine, nous allons toucher moins d’argent issu de la redevance, et comme la publicité décroît chaque année, nous avons environ une centaine de
millions de francs d'économies à faire à l'échelle nationale dès 2019. C'est assez conséquent, car on vient déjà de faire des économies d'une cinquantaine de millions il
y a deux ans. Ce qui veut dire qu'en trois ans, la SSR aura dû économiser 10 % de son budget. Pendant ce temps, il n'y a pas une modification du mandat, donc on doit continuer à
garantir une qualité de prestation égale dans toutes les régions. Il s’agit donc de produire moins cher, de revoir nos infrastructures pour qu'elles soient moins coûteuses, et de faire
en sorte d'être le plus efficient possible. Concrètement, cela suppose de réduire la masse salariale, revoir le mandat, fermer un certain nombre des chaînes de télévision ou des radios
? Pascal Crittin : > On doit ouvrir la maison beaucoup plus, afin de permettre au public > de comprendre pourquoi il paie la redevance Nous allons aborder cette question après le 4
mars. Aujourd’hui, nous sommes engagés dans le débat lié à la votation. Mais dès le 5 mars, c'est le chantier prioritaire. Le deuxième chantier est parallèle, c'est la suite de la
transformation de l'entreprise, et cela sur deux plans : la digitalisation des médias, et la relation avec le public. On doit débattre de nos choix éditoriaux, ouvrir la maison beaucoup
plus, afin de permettre au public de comprendre pourquoi il paie la redevance. À qui profiterait la disparition de la redevance ? Pascal Crittin : Je pense qu’au regard des difficultés que
rencontrent les éditeurs de presse avec les journaux, il y a peu de chances qu’ils investissent massivement dans la télévision. Il y aura peut-être une ou deux télévisions commerciales, mais
ce n'est pas ça qui va garantir, ni la qualité ni la diversité de l'information et des programmes culturels, musicaux et sportifs. Est-ce que des acteurs étrangers vont venir
investir en Suisse? Aujourd’hui, en Suisse romande, TF1, M6 et beaucoup d'autres télévisions ouvrent simplement des fenêtres avec des spots publicitaires suisses. L'argent quitte
la Suisse pour Paris, et il n’y a aucune production suisse en retour. Donc pourquoi viendraient-ils soudainement produire en Suisse ? C'est une grave perte pour notre pays. Qui sont les
gagnants ? C'est difficile à dire, parce que 85 % de notre production n'est pas rentable. À la fin, l'initiative prévoit que les concessions doivent être mises aux enchères.
Le plus offrant va obtenir des concessions, mais pour faire quel programme ? Et avec quelle intention commerciale ou politique ? Ceux qui vont gagner, ce sont ceux qui vont réussir à capter
les 280 millions de publicités de la SSR : principalement les GAFA et les télévisions étrangères. Mais comme ils ne vont rien produire ou presque en Suisse, parce que c’est trop cher, tout
le pays va perdre. C'est très cynique. Je pense que cette initiative ne va profiter à personne. Mais indéniablement, le grand perdant, c'est le public, et la Suisse en général.
[NDLR : l'interview a été réalisée le 14 février 2018, et depuis, les sondages ont évolué] -- Crédit photo : Laurent Bleuze