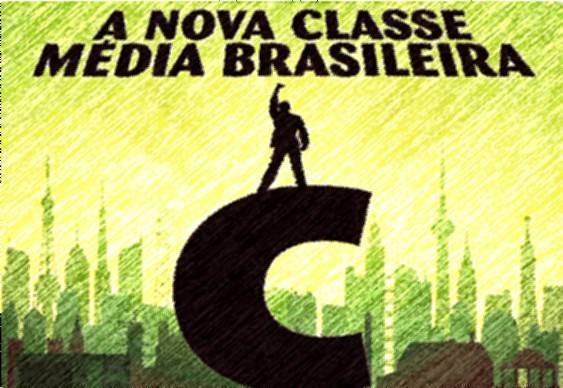- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
L’internet, on le dit souvent, serait un espace ouvert, sans frontières, où les droits nationaux ne trouveraient pas à s’appliquer : or, cette affirmation est inexacte. Il conviendrait
plutôt de dire que l’Internet crée un espace nouveau, le cyberespace, où les notions de frontière et de souveraineté juridique doivent être envisagées d’un regard nouveau, ce que nous allons
faire. Avant de s’interroger sur l’opportunité de créer un cyberespace proprement européen, il faut savoir ce que cela pourrait signifier et, pour cela, préciser les grandes lignes de la
géographie du cyberespace et des règles de circulation qui y sont appliquées. LE CYBERESPACE, UN ESPACE COMMUN MONDIAL > L’espace aérien est celui qui ressemble le plus au cyberespace :
> l’avion qui vole au-dessus de l’océan est dans un espace qui > n’appartient à personne, mais dès qu’il survole un pays, il > doit obéir à ses autorités étatiques Nous proposons de
définir le cyberespace comme l’ensemble des données numérisées (logiciels et documents textuels, sonores, graphiques ou visuels) disponibles sur l’Internet et des infrastructures
matérielles et logicielles qui leur confèrent l’ubiquité. Le cyberespace est un espace commun mondial, de même que la haute mer au-delà de la limite des eaux territoriales, l’espace aérien
et l’espace exo-atmosphérique (tous nommés en anglais _Global Commons_). De ces quatre espaces communs, l’espace aérien est celui qui ressemble le plus au cyberespace : l’avion qui vole
au-dessus de l’Océan atlantique ou de l’Antarctique est dans un espace qui n’appartient à personne, mais dès qu’il survole un pays il est dans son espace aérien, il doit obéir à ses
autorités étatiques, et l’aéroport où il atterrit appartient à un propriétaire public ou privé, sur le territoire d’un État souverain. Il en va de même dans le cyberespace, les fibres
optiques où circulent les données ont des propriétaires, ainsi que les routeurs(1) qui sont les postes d’aiguillage du réseau et les points d’échange (_Internet Exchange Points_, IXP) où
sont concentrés les routeurs principaux, qui permettent les échanges entre les différents réseaux (comme les détroits et les canaux dans l’espace maritime), parce que l’Internet est un
réseau de réseaux, comme nous allons le voir. Toutes ces infrastructures ont des propriétaires et, hormis les fibres optiques qui reposent au fond des océans, sont situées sur le territoire
d’États souverains. Juridiquement et techniquement, rien ne s’oppose à la création d’un réseau fermé, national ou privé, en tout point analogue à l’internet, il suffit de mettre en place les
infrastructures adéquates, dont les éléments constitutifs sont en vente libre dans le monde entier, et pour les logiciels beaucoup sont des logiciels libres qu’il suffit de télécharger.
Plus difficile, mais possible : délimiter un cyberespace national, qui communique avec l’internet mondial par des écluses, si l’on peut user de cette métaphore, destinées à contrôler les
données en transit pour vérifier qu’elles respectent la législation locale, par exemple. La réalisation la plus accomplie dans cette direction est l’internet chinois, relié à l’internet
global mais avec d’importantes restrictions que nous examinerons ci-dessous. Le dispositif chinois, il faut le savoir, a demandé des investissements considérables et la mobilisation de
milliers d’ingénieurs, mais ses coûts ne sont pas limités à ces aspects tangibles : il faut y ajouter la perte de possibilités d’échanges intellectuels, culturels ou commerciaux, dont
certains ne sont justement pas souhaités, alors que d’autres seraient profitables. GÉOGRAPHIE DU CYBERESPACE Le cyberespace, que l’on imagine parfois comme virtuel, repose en réalité sur des
infrastructures massives et coûteuses, mais dont l’internaute a peu conscience parce que les données circulent dans les fibres optiques et les commutateurs à une vitesse proche de celle de
la lumière, ce qui en fait un espace où les distances sont nulles. Les entités qui peuplent le cyberespace, ordinateurs ou objets analogues tels que téléphones et routeurs, sont appelés
_nœuds_, dotés chacun d’un ou plusieurs numéros IP (comme _Internet Protocol_, on dit aussi adresse IP). Une adresse IP a deux fonctions : elle identifie le nœud qui la possède et permet
aussi sa localisation. > Dans le cyberespace, les données circulent à une vitesse proche de > celle de la lumière, ce qui en fait un espace où les distances > sont nulles L’Internet
est, comme nous l’avons déjà signalé, un réseau de réseaux. Chacun de ces réseaux est la propriété d’un opérateur (FAI, comme « fournisseur d’accès à l’Internet », ou en anglais ISP,
_Internet Service Provider_) différent, qui l’administre à sa façon. Un réseau administré de façon unique par un ISP est un _Autonomous System_ (AS) ; si l’on compare l’Internet à un
continent, les AS en sont les pays, séparés par des frontières, avec chacun sa législation. Un grand FAI peut posséder plusieurs AS, à l’instar d’un État fédéral. Chaque AS est identifié par
un numéro d’AS. L’Internet est constitué d’à peu près 54 000 AS (avril 2016), dont le plus grand (AS 4134, Chinanet-Backbone) comporte plus de 120 millions d’adresses IP, et le plus petit
(AS 2111) un seul ordinateur. À l’intérieur d’un AS, les routeurs appartiennent au FAI ou à ses clients et sont administrés selon les règles qu’il a fixées. Pour que l’Internet existe et
puisse fonctionner, il faut établir des communications entre AS de FAI différents : pour ce « passage de frontière », un FAI disposera des routeurs de frontière de système autonome,
directement reliés aux routeurs de frontière des FAI avec qui il veut établir une liaison. Le point auquel seront placés ces routeurs s’appelle un _Internet Exchange Point_ (IXP). Les règles
qui régissent le transit par un IXP sont fixées par des accords d’appairage _(__peering)_ ou de transit entre les ISPs. Les accords d’appairage sont basés sur la réciprocité et ne donnent
pas lieu à facturation, cependant que le transit est fourni à titre onéreux, généralement par un gros FAI propriétaire d’une infrastructure mondiale à un plus petit. > Une défaillance du
routage global pourrait provoquer une partition > de l’Internet Pour que l’Internet fonctionne, il existe une table de routage globale ; elle comporte (en mars 2016) plus de 600 000
entrées ; elle est disponible, par exemple, sur le site de l’Asia Pacific Network Information Centre (Apnic) ; les routeurs de frontière des principaux FAI doivent la maintenir à jour
quotidiennement. La question du routage est moins connue du public que celle du Système de noms de domaine (DNS), parce qu’elle est moins visible, mais elle est au moins aussi importante.
Une défaillance du routage global pourrait provoquer une partition de l’Internet. SYSTÈME DE NOMS DE DOMAINE (DNS) Le DNS est, fondamentalement, l’annuaire de l’Internet. Comme l’annuaire du
téléphone, il établit, par le truchement d’un logiciel appelé résolveur, une correspondance entre un _nom de domaine_ tel que www.inaglobal.fr et un numéro IP, en l’occurrence
195.221.139.136(2). Cette opération est indispensable pour au moins deux raisons : tout d’abord, il serait peu amical de contraindre les internautes désireux de visiter le site Web de l’Ina,
à se souvenir de l’adresse IP 195.221.139.136, mais, de plus, si l’Ina déménage ou change de FAI, cette adresse changera, alors que le nom de domaine persistera. > La question se pose
donc à l’Union européenne de savoir si elle > veut accroître son indépendance dans le cyberespace L' Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann) supervise
l’attribution des noms de domaines et des adresses depuis sa création en 1998, sous le contrôle de la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), une branche du
Department of Commerce américain. Superviser le fonctionnement du DNS mondial, à l’heure où la politique, l’économie et la culture mondiales sont organisées autour de l’Internet, confère
bien sûr un pouvoir considérable, en l’occurrence au gouvernement des États-Unis, même si cette supervision n’implique pas un contrôle général, et n’empêche pas un acteur résolu à y
consacrer des moyens importants de mener une politique indépendante dans ce domaine, ce qu’a fait le gouvernement chinois. La question se pose donc à l’Union européenne de savoir si elle
veut accroître son indépendance dans le cyberespace, pourquoi et comment. UN MODÈLE DU CYBERESPACE Pour représenter une réalité complexe qui peut être abordée selon différents niveaux
d’abstraction, il peut être commode d’en construire un modèle en couches, afin de traiter chaque niveau indépendamment des autres. Pour le cyberespace, nous proposons ici un modèle en quatre
couches : • couche 1 : les infrastructures physiques, fibres optiques, IXP, routeurs et commutateurs ; • couche 2 : contrôle et supervision, les tables de routage, le DNS, les logiciels qui
en assurent le fonctionnement ; • couche 3 : couche logique, les données visitées par l’internaute, son navigateur, les logiciels des serveurs ; • couche 4 : couche cognitive, les
interactions entre les humains et les couches inférieures, dont l’activité des ingénieurs qui assurent le fonctionnement et l’évolution de l’Internet, notamment au sein d’organismes de
concertation, de coopération et de normalisation tel que l’IETF). GRANDES PUISSANCE CYBERSPATIALES La visibilité éminente du DNS, perçue par tout internaute qui réfléchit deux secondes à ce
qu’il fait en bavardant sur Facebook, focalise le débat politique autour de l’Internet sur le rôle de l’Icann, qui est effectivement l’enjeu de conflits et d’âpres négociations. La démission
récente de son directeur Fadi Chehadé témoigne de ces conflits, qui ne doivent pourtant pas masquer les enjeux au moins aussi importants du routage et des infrastructures, qui se négocient
dans l’ombre au prix de budgets bien plus importants. Si l’on s’en tient aux chiffres, le budget annuel de l’Icann est un peu supérieur à une centaine de millions de dollars, le millième du
chiffre d’affaires d’un FAI géant tel que Verizon Communications ; la pose du moindre faisceau de fibres optiques transocéanique représente plusieurs années de fonctionnement de l’ICANN : le
câble Honotua inauguré en 2010 entre Tahiti et Hawaï, long de plus de 4 600 km pour un débit de 320 gigabits par seconde, a coûté 75 millions d’euros, le câble SEA-ME-WE 4 (South East
Asia-Middle East-Western Europe 4), long de 20 000 km, qui relie Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Bangladesh, l’Inde, le Sri Lanka, le Pakistan, les Émirats arabes unis, l’Arabie
saoudite, l’Égypte, l’Italie, la Tunisie, l’Algérie et la France, est entré en service en décembre 2005 et a coûté 500 millions de dollars, pour une capacité de 3,84 Tbps. > Les plus
grands FAI sont si importants que tous les autres > opérateurs n’ont d’autre choix que de leur donner accès > gratuitement à leurs réseaux Les plus grands FAI forment une aristocratie
du Net nommée Tier 1_,_ en effet, ils n’ont à acheter à personne ni transit ni appairage, ils sont si importants que tous les autres opérateurs n’ont d’autre choix que de leur donner accès
gratuitement à leurs réseaux, et d’ouvrir la porte à leurs paquets. Ils sont en 2016 au nombre de 16, dont quatre européens (Deutsche Telekom_,_ désormais connu sous le nom International
Carrier Sales & Solutions, ICSS, Seabone_, _en faitTelecom Italia Sparkle_, _Open Transit_, _en faitOrange et le Suédo-Finnois TeliaSonera International Carrier). L’indépendance d’un
opérateur peut aussi se mesurer au fait qu’il n’a pas d’adresse de routage complète de l’Internet, il ne dépend pas d’un autre FAI pour sa connectivité. Les opérateurs dans cette situation
forment la _Default-free zone,_ ou DFZ. INDÉPENDANCE DANS LE CYBERESPACE ? La sénatrice française Catherine Morin-Desailly a publié le 20 mars 2013, au nom de la commission des affaires
européennes du Sénat, un rapport intitulé _L’Union européenne, colonie du monde numérique ?_, ce qui suggère à tout le moins que la recherche d’une plus grande indépendance dans le
cyberespace aurait un sens. Nous pouvons partir du modèle en quatre couches présenté ci-dessus pour voir quels sont les facteurs d’indépendance à améliorer en Europe. > Un pays doté d’une
centralité importante peut facilement > observer ou perturber les communications d’autres pays D’abord la couche 1 correspondant aux infrastructures : les chercheurs Josh Karlin,
Stephanie Forrest et Jennifer Rexford, dans leur article Nation-State Routing: Censorship, Wiretapping, and BGP, ont défini une métrique de centralité d’un pays dans l’Internet, qui mesure
sur une échelle de 0 à 1 la difficulté de trouver, pour aller d’un point à un autre du réseau, un chemin qui évite le pays en question. Comme on a pu le remarquer, un pays doté d’une
centralité importante peut facilement observer ou perturber les communications d’autres pays, cependant qu’un pays à faible centralité peut difficilement éviter l’espionnage et les
perturbations causées par d’autres pays. Les États-Unis ont une centralité de 0,74, la France de 0,14, la Chine de 0,07 et le Pakistan de 0,0002. Notons que si la Chine a une centralité
faible, c’est à dessein ; l’Internet chinois est fermé par un ensemble de dispositifs nommé _Bouclier doré_ : peu de connexions avec l’extérieur, des milliers d’agents scrutent l’activité
des internautes, et un DNS à deux niveaux. Un premier niveau accepte les noms de domaines en sinogrammes mais les tronque pour ne donner accès qu’aux sites installés sur le territoire
chinois : ainsi pour les noms se terminant en “.com.cn”, “.net.cn”, le suffixe “.cn” n’apparaît plus à la fin dans la fenêtre du navigateur. Le résultat est que tout internaute chinois
utilisant les idéogrammes est cantonné sur ce sous-réseau, déconnecté de la Toile, et directement contrôlé par Beijing. C’est une façon d’assurer son indépendance, mais nous ne croyons pas
que ce soit ce que peuvent souhaiter les Européens. L’Europe n’est pas sous-équipée en infrastructures : si une grande partie de son trafic part outre-Atlantique, c’est pour des raisons plus
culturelles que techniques, que nous examinerons ci-dessous.En ce qui concerne la couche 2 (contrôle et supervision), il faudra améliorer son indépendance, c'est-à-dire accroître
accroître son influence dans les instances où se décident l’organisation et l’avenir de l’internet. Envoyer des ingénieurs et des chercheurs aux réunions de l’IETF est une bonne chose, mais
leurs interventions y auront d’autant plus de poids que l’on sentira derrière eux la force de centres de recherche et d’industriels du réseau. L’Europe possède de bonnes équipes de
recherche, son industrie s’est effondrée, mais un rebond est possible avec le développement desméthodes de pilotage de réseau par logiciel (_Software Defined Network,_ SDN). Encore
faudrait-il coordonner des efforts dans ce domaine. > Les GAFA, drainent les données du public mondial en direction des > États-Unis La couche 3, qui correspond à la logique constitue
le point le plus difficile. Des opérateurs géants, Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA, drainent l’intérêt et, par conséquent, les données du public mondial en direction des
États-Unis. Leur puissance est au moins autant culturelle que financière et technique. Ce phénomène, avec d’autres acteurs dans le passé, IBM notamment, a commencé avec la troisième
révolution industrielle née de l’informatisation du monde, et déjà les successeurs des GAFA se pressent à la porte, Uber, Bookin et d’autres. À la récolte systématique des données et des
budgets, ces entreprises pratiquent l’optimisation fiscale, rien d’autre qu’un pillage qui exploite habilement les failles des législations. > L’Europe avance à reculons vers le monde
nouveau Une révolution culturelle ne se commande pas : on peut simplement essayer de ne pas lui opposer trop de barrières. L’Europe doit s’engager résolument dans la voie de cette révolution
industrielle en encourageant le développement de l’économie qui lui correspond, et que nous proposons de baptiser _iconomie_. Actuellement l’Europe, et plus particulièrement la France, fait
exactement le contraire ; la nouvelle économie et la mondialisation qui est son corollaire sont vues comme des menaces, et de vains et coûteux efforts sont consentis pour essayer de sauver
des activités de toute façon condamnées. S’y ajoute le scandale de la liquidation irresponsable d’activités stratégiques : Alstom, Areva, Péchiney... L’Europe avance à reculons vers le monde
nouveau. Il est vital de changer d’attitude et d’embrasser _l’iconomie._ L'Europe possède une caractéristique dont elle peut sans doute faire un avantage compétitif par rapport au
reste du monde : elle est la seule région au monde à avoir un réel souci de la protection des données, personnelles et publiques, avec une politique suivie dans ce domaine et un cadre
législatif qui demanderait sans doute quelques aménagements pour s'adapter au monde nouveau de l'_iconomie_, mais qui a le mérite d'exister. Enfin, la couche 4, cognitive, est
sans doute le point le plus important : pour gagner son indépendance dans la couche cognitive du cyberespace, le facteur clé est le système éducatif. Il est vital d’introduire vraiment
l’informatique à l’école. L’informatique, c’est apprendre la programmation des ordinateurs, le système d’exploitation, le réseau, les circuits électroniques : ce n’est pas seulement
distribuer des tablettes et bavarder sur les réseaux sociaux. Les pays qui pointent en tête de la révolution cyberindustrielle, Corée du Sud, Taïwan, Israël, Singapour, l’ont fait,
l’Angleterre s’y engage, d’autres aussi, nous _devons_ en faire autant. -- Ina. Illustration Alice Durand Crédit photo : - _World connection_, Colin Harris ADE, Flickr INTERNET, ÇA SERT,
D’ABORD, À FAIRE LA GUERRE - ÉPISODE 3/11 Dès les années 1980, l’avènement de l’informatique et la naissance de l’internet ont reconfiguré les conflits armés. Les États mais aussi des
acteurs non étatiques se sont approprié un nouveau domaine en perpétuelle expansion, le cyberespace.