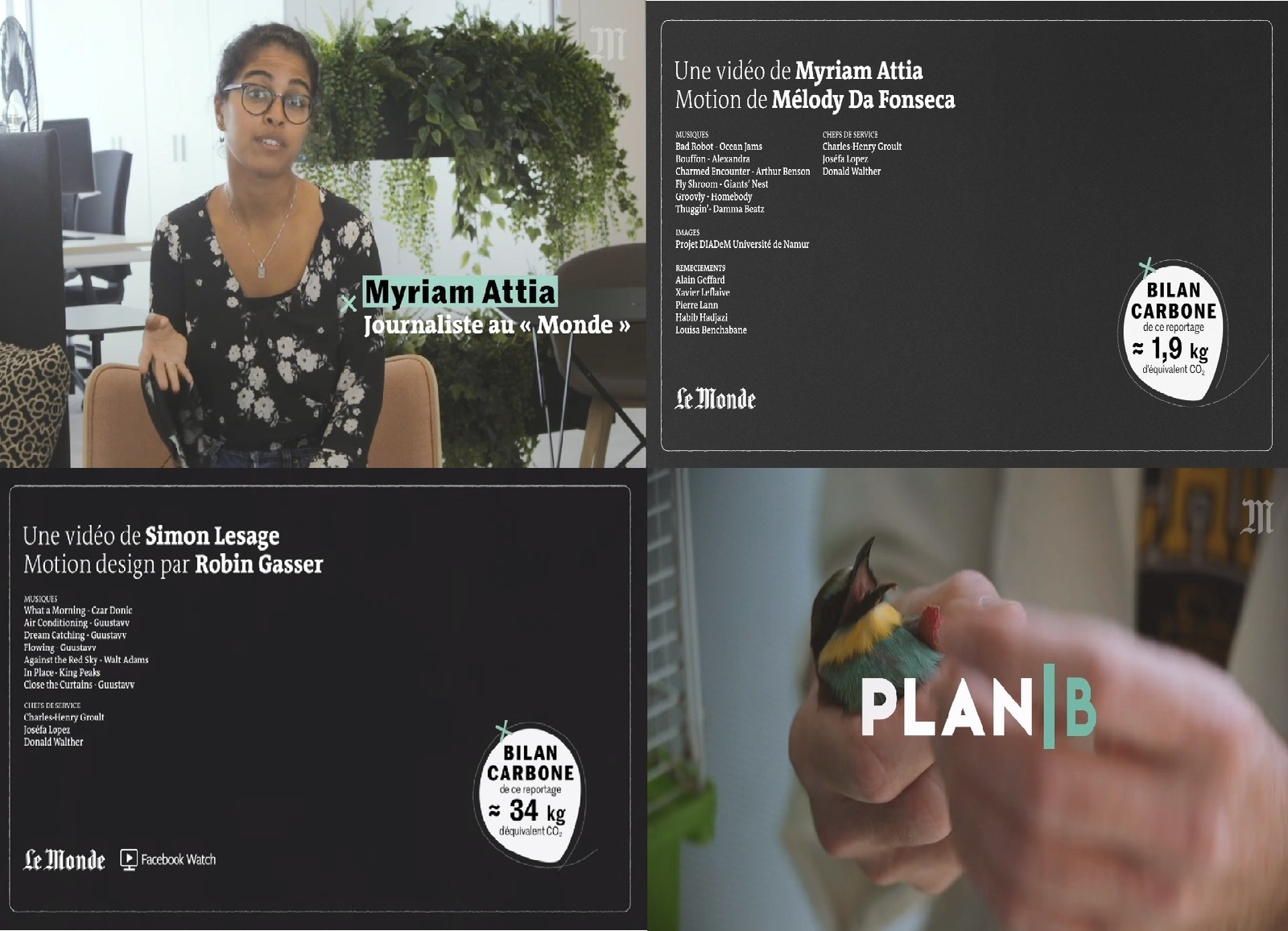- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
© Crédits photo : INA. Illustration : Émilie Seto. Twitter est un service original qui se situe au croisement de plusieurs fonctions : réseau social, micro-blogging, recommandation et
partage de liens, tchat, réseau professionnel. Nikos Smyrnaios Publié le 30 août 2010 INTRODUCTION Twitter est un service original qui se situe au croisement de plusieurs fonctions : réseau
social, micro-blogging, recommandation et partage de liens, tchat, réseau professionnel. Sa nature multiple, permettant une grande variété d’usages, et la simplicité de son interface ont
largement contribué à son succès. Actuellement, Twitter est l’un des services les plus dynamiques de l’internet mondial : en avril 2010, le nombre de comptes enregistrés a dépassé les cent
millions (160 millions selon le blog Twitter en novembre et plus de 200 millions selon les estimations du New York Times), avec un rythme de 370 000 nouveaux comptes par jour, et le nombre
de messages échangés est désormais proche des 100 millions par jour (avec une moyenne de 90 millions de tweets) alors qu’il était déjà supérieur à cinquante millions par jour en février 2010
—dont pratiquement un million émis depuis la France—, mille deux cents messages par seconde. Pour découvrir en temps réel les tweets dans le monde, la société de conseil en innovation Frog
Design a mis en place le site A World of Tweets. A titre indicatif, la France est figure en douzième position du top 20 des pays ayant la plus grande activité sur Twitter avec 1,44% du
nombre total de tweets émis. _SOURCE : BLOG OFFICIEL DE TWITTER._ Créé en 2006 au sein de la société Odeo par Jack Dorsey, rapidement rejoint par Biz Stone et Evan Williams, Twitter procède
en 2007 à sa première levée de fonds et devient une société distincte d’Odeo. Depuis, Twitter a levé plus de 160 millions d’euros auprès des principales sociétés de capital-risque des
États-Unis. Twitter permet à ses membres de publier sur leur page personnelle (_timeline_) des courts messages (140 caractères maximum) accessibles à l’ensemble des abonnés (_followers_)
tout en suivant les flux produits par les différents utilisateurs (_following_). Outre cette fonctionnalité de base, de nombreuses autres, plus ou moins sophistiquées, sont disponibles :
adresse d’un message direct à un membre du réseau (_direct message_) ; retransmission des messages d’autres utilisateurs (_retweet_) ; création, suivi et partage des listes de comptes ;
recherche avancée, etc. DU RÉSEAU SOCIAL AU « RÉSEAU D’INFORMATION » Le concept initial de Twitter est fondé sur une idée simple : permettre à ses utilisateurs de dire ce qu’ils font en
temps réel — d’où son premier slogan : « _What are you doing ? _» (« Qu’est-ce que tu fais ? »). Progressivement, le service a évolué de la communication interpersonnelle, ou de groupe à
petite échelle, vers la socialisation de masse, et Twitter est en quelque sorte devenu un outil de veille collective sur une multitude de sujets. À partir de 2009, afin de refléter les
nouveaux usages développés, un nouveau slogan s’affiche sur la page d’accueil : « _Discover what’s happening right now, anywhere in the world _» (« Découvre ce qui se passe maintenant,
partout dans le monde »). Selon ses fondateurs, plus qu’un simple réseau social, Twitter constitue dès lors un véritable « réseau d’information». La notoriété de Twitter auprès du grand
public et des médias (Uscali, 2009) s’est en effet construite à partir de la couverture des faits d’actualité et des « scoops » que ses utilisateurs ont produits, et non pas, comme dans le
cas de Facebook, grâce à un taux de pénétration très élevé, auprès des jeunes notamment. Ainsi, les utilisateurs de Twitter ont rendu compte, sur place, des attaques terroristes de Bombay
(novembre 2008) et des émeutes urbaines en Grèce (décembre 2008) ; plus récemment, la photo de l’amerrissage d’urgence d’un avion de la compagnie US Airways sur la rivière Hudson à New York
(janvier 2009) diffusée par un seul et simple utilisateur a fait le tour du monde. Mais c’est avec l’élection présidentielle iranienne de juin 2009 que toute l’efficacité du service en tant
que média d’information a été établie : Twitter, l’un des rares moyens d’information non censuré par le régime iranien, a été utilisé par les opposants pour communiquer avec l’extérieur du
pays et montrer l’ampleur de la mobilisation et de la répression — un tel usage militant avait déjà été observé en Afrique (Mäkinen & Kuira, 2008). Ces événements ont ainsi été
l’occasion de mettre en avant les avantages du service : rapidité de la diffusion de l’information ; couverture quasiment en temps réel depuis l’endroit où « ça se passe » grâce à
l’utilisation des téléphones portables ; diffusion de contenus multimédia par le biais de services associés ; incapacité des autorités à censurer les flux d’information transitant par
Twitter, à moins de bloquer l’accès à l’Internet. API OUVERTE ET INNOVATION PAR L’USAGE Cette efficacité de Twitter en tant que moyen de dissémination de l’information est due à la fois à
ses caractéristiques techniques et à l’appropriation sociale de l’outil. Dès le départ, Twitter a été conçu comme un service adapté aux supports mobiles. De la longueur des messages limitée
à 140 caractères (la même que pour un SMS donc (1)) à la simplicité de l’interface, tout a été pensé afin de pouvoir directement bénéficier du développement exponentiel de la téléphonie
mobile. Par ailleurs, le choix de mettre en œuvre des outils _open source_ et de rendre l’interface de programmation (API) du service accessible à des tiers a été déterminant pour son succès
et, dans un même temps, a favorisé l’émergence d’un écosystème constitué de dizaines de services interopérables qui permettent de consulter Twitter sans passer par un navigateur web :
géolocalisation (FourSquare), raccourcisseurs de liens (Bit.ly), hébergement de photos et de vidéos (Twitpic), moteurs de recherche (Topsy) et clients qui permettent de consulter Twitter
sans passer par un navigateur web. Selon Jack Dorsey, l’API de Twitter serait vingt fois plus sollicitée par le biais d’applications extérieures que ne l’est le site Twitter.com — autrement
dit, une grande majorité des membres accède aux informations qui circulent sur Twitter par d’autres moyens que par le site lui-même. Twitter n’est donc principalement ni une plate-forme
fermée comme Facebook, ni un portail, mais un flux d’information mis à jour en temps réel et visualisable sur des supports extrêmement variés, ce qui rend la censure par une instance
extérieure quasiment impossible. Les responsables de Twitter ont su également mettre à profit « les innovations par l’usage », c’est-à-dire les « innovations technologiques ou de services
qui naissent des pratiques des usagers et se diffusent à travers des réseaux d’échanges entre usagers » (Cardon, 2005). En effet, nombre de fonctionnalités de base de Twitter — faire
précéder le nom d’un utilisateur par le signe @ pour le désigner, l’utilisation des _hashtags_ (mots clés précédés par #) pour définir le sujet d’un message ou le _retweet_ — ont été
inventées par les utilisateurs. Les ingénieurs de Twitter n’ont fait que suivre le mouvement en adaptant l’interface du service aux fonctionnalités déjà adoptées par une part importante des
utilisateurs. PROPAGATION DE L’INFORMATION ET « CLASSES » D’UTILISATEURS De nombreuses études quantitatives menées par extraction automatique des données depuis l’API de Twitter visent à
cartographier la circulation de l’information dans le réseau et à qualifier les groupes d’utilisateurs et les groupes de messages. L’agence française Spintank par exemple a tenté de tracer
la propagation de l’information autour de la censure de la loi Création et Internet (Hadopi) annoncée le mercredi 10 juin 2009. L’étude montre tout d’abord que si le bouche à oreille autour
d’une actualité, communément désigné comme _buzz_, est souvent intense, il est de courte durée : quand on classe les messages suivis du _hashtag_ #hadopi en trois catégories : information,
analyse, satire/ironie, on s’aperçoit en effet qu’à mesure que l'on s’éloigne de l’annonce de la censure de la loi, la proportion des deux dernières catégories s'accroît aux dépens
des _tweets_ purement informatifs. Cependant, dans l’ensemble, ce sont les annonces de l’événement qui sont dominantes (la moitié des _tweets_ labellisés #hadopi), ce qui tend à montrer que
Twitter est avant tout un média de diffusion d’information brute. Par ailleurs, en comparant l’articulation des prises de parole (_tweets_) et la rediffusion (_retweets_), la même étude
montre que la rediffusion est très forte quand l’information exclusive est donnée par quelques décideurs bien informés (en l’occurrence des journalistes spécialisés dans les nouvelles
technologies), et qu’elle diminue au fur et à mesure que l’information se répand dans les médias. On constate d’autre part que l’impact d’un message diffusé sur Twitter dépend moins de
l’information qu’il contient que du statut de celui qui l’émet, puisqu’à publication d’information identique, le nombre de _retweets_ varie radicalement. Pourtant, le _retweet_ est un outil
de diffusion particulièrement puissant : dès qu’un message est « retweeté », il est susceptible de toucher en moyenne 1000 utilisateurs, et ce indépendamment du nombre de _followers _de
l’émetteur qui en est à l’origine (Kwak & al., 2010). Ceux qui bénéficient le plus de la rediffusion de leurs messages sont ceux qui disposent d’une « autorité numérique » élevée, en
l’occurrence des journalistes web et des technophiles reconnus, mais pas forcément ceux qui sont suivis par un nombre élevé de personnes (Cha & al., 2010). Cette caractéristique de
Twitter n’est pas surprenante, elle s’inscrit dans la lignée des recherches historiques sur les médias qui ont mis en exergue le rôle déterminant des leaders d’opinion dans les processus de
réception et de circulation des messages (Katz & Lazarsfeld, 1955). Sur ce dernier point, les résultats de Spintank rejoignent ceux d’une étude menée en mai 2009 (Heil & Piskorski,
2009) sur un échantillon de 300 000 comptes Twitter qui a établi que 10 % des utilisateurs produisent 90 % des messages, ce qui suggère une diffusion de l’information relativement
centralisée. Ces résultats coïncident également avec ceux de l’étude du cabinet Sysomos : sur 11,5 millions de comptes Twitter analysés, 5 % des utilisateurs génèrent 75 % de l’activité du
réseau. Comme l’a montré Albert-László Barabási dans son ouvrage de référence (Barabási, 2002), une telle concentration de l’activité autour d’un petit nombre de nœuds est une
caractéristique commune à de nombreux réseaux de nature différente. Cette structure inégale est confirmée quand, en analysant les flux d’information qui circulent sur Twitter, on classe les
utilisateurs en fonction de leur influence et de leur activité (Krishnamurthy & al., 2008 et Java & al., 2007) : le groupe appelé _information sources_ ou _broadcasters_,
correspondant peu ou prou à l’élite de Twitter qui bénéficie simultanément d’un large public et de reprises très nombreuses, est en effet majoritairement constitué d’utilisateurs jouissant
d’une notoriété antérieure à leur arrivée sur Twitter : comptes officiels (médias, sociétés), journalistes ou personnalités connues dans leur domaine respectif… Ce déséquilibre de la
structure est également souligné par le faible pourcentage de réciprocité de suivi entre utilisateurs ainsi que par le faible taux de communication directe entre eux (Kwak & al., 2010 ;
Huberman & al., 2010). La catégorie des utilisateurs de Twitter les plus influents constitue une cible importante pour le marketing parce qu’elle est un relais important au niveau de la
notoriété des marques et des produits mais également au niveau du trafic redirigé vers des sites Internet. Ce dernier point intéresse particulièrement les sites d’information qui tentent
d’exploiter les réseaux sociaux pour augmenter leur audience. LA PLACE DE TWITTER DANS L’ACTUALITÉ Un autre pan d’études relatives aux usages de Twitter se focalise sur le domaine de
l’actualité et tente de saisir la manière dont le service participe au processus de production, de diffusion et de consommation des _news_. À ce propos, une question cruciale pour les sites
d’information est de savoir quels sont leurs principaux référenceurs. Pour ce faire, la société Hitwise a mesuré la provenance des visites reçues par l’ensemble des sites d’information
américains. Sans surprise, le plus gros pourvoyeur d’audience est Google (17,3 % pour 2009), suivi de loin par d’autres géants du web : Yahoo, MSN et Facebook. Twitter en revanche n’arrive
qu’à la 39e place des référenceurs avec seulement 0,14 % de trafic généré. On notera cependant que l’étude prend uniquement en compte les visites engendrées depuis le site Twitter.com., or,
comme nous l’avons mentionné précédemment, la plus grande partie de l’activité de Twitter provient des plates-formes autres que le site Twitter.com et donc est de fait exclue des calculs de
Hitwise. Selon trois études récentes de l’institut Pew Internet, Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux semblent néanmoins s’intégrer progressivement dans les pratiques d’accès à
l’information d’actualité d’une part croissante de la population internaute, notamment aux États-Unis. La première de ces études établit qu’en 2009, un internaute américain sur trois utilise
un service (Twitter ou assimilé) pour mettre à jour son statut en ligne, soit pratiquement le double qu’en 2008. Les groupes moteurs de cette tendance sont les jeunes internautes et ceux
qui se connectent souvent à l’Internet depuis leur téléphone mobile. La deuxième étude est issue du Project for Excellence in Journalism (PEJ), une émanation de Pew Internet, et concerne
plus précisément les modalités de consommation de l’information en ligne par les internautes américains. 37 % des personnes interrogées déclarent avoir contribué à créer du contenu en ligne
ou avoir commenté et disséminé l’information via des blogs et des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ; parmi elles, 17% déclarent avoir posté un lien vers une actualité sur un réseau
social en général, et 3 % en avoir transmis précisément sur Twitter. 51 % des utilisateurs des réseaux sociaux disent recevoir des nouvelles de la part d’autres membres auxquels ils sont
connectés et 23 % suivent un média d’information directement dans un réseau social. Cette tendance est également observée en France dans des études récentes concernant les modes d’accès et
de consommation de l’actualité (Granjon & Le Foulgoc, 2010). La troisième étude du PEJ fait partie du rapport State of the Media 2010 et donne quelques éléments plus qualitatifs,
notamment sur le rapport qu’entretiennent les utilisateurs des réseaux sociaux, et de Twiter plus particulièrement, avec l’agenda médiatique dominant. Les chercheurs du PEJ ont suivi pendant
un an les sujets les plus en vue dans les médias américains et les ont comparés avec les contenus les plus repris dans les médias sociaux. Cette étude montre que les nouvelles qui attirent
le plus l’attention dans les blogs et les réseaux comme Facebook et Twitter diffèrent sensiblement de celles qui font la une des médias traditionnels. Twitter semble le plus éloigné de
l’agenda dominant : les nouvelles les plus reprises n’ont coïncidé qu’une fois sur six avec celles qui ont été le plus traitées par les médias professionnels. En outre, le sujet le plus
discuté, avec plus de 10% de _top stories_, est… Twitter lui-même (ses projets, ses pannes, etc.). Globalement, les sujets technologiques sont très fortement présents parmi les nouvelles les
plus reprises sur Twitter alors que ses utilisateurs partagent proportionnellement peu de nouvelles concernant la politique et les questions de société. Enfin, les chercheurs du PEJ ont mis
en évidence un décalage entre les sources d’information citées par les blogueurs et celles citées par les utilisateurs de Twitter. Les premiers se basent essentiellement sur des médias
traditionnels : 80 % de liens qui proviennent des blogs mènent vers les sites des journaux et des stations de TV et de radio, avec trois sources ultra-dominantes (New York Times, CNN et
BBC). À l’inverse, les utilisateurs de Twitter partagent des liens qui renvoient autant vers les sites des médias traditionnels que vers des pure-players du web (31,6 % pour chaque
catégorie). L’USAGE DE TWITTER PAR LES JOURNALISTES Au-delà du rôle qu’il joue désormais dans la diffusion de l’actualité, Twitter constitue un outil dans le processus de production de
l’information. Deux études américaines récentes montrent ainsi que les journalistes tendent de plus en plus souvent à utiliser Twitter dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes.
Selon l’enquête du cabinet PR Newswire, sur un échantillon de 1 568 journalistes américains interrogées, 37 % utilisent désormais régulièrement Twitter, 33 % utilisent les réseaux sociaux
dans leurs recherches d’information et 24 % considèrent Facebook et Twitter comme des moyens importants pour trouver et contacter des experts. Cette montée en puissance de l’usage de Twitter
par les journalistes professionnels est également observée dans une étude menée conjointement par l’Université George Washington et l’institut Cision auprès d’un échantillon de 371
journalistes. 56 % d’entre eux déclarent que les médias sociaux sont importants dans leur recherche d’information et la conception des contenus. Sans surprise, ceux qui y attribuent le plus
d’importance sont les journalistes des sites d’information (69 %), suivis par ceux qui travaillent pour la presse écrite (59 %). Pour ce qui est de la promotion de leur production, le moyen
le plus utilisé est le blog (64 %), suivi par Facebook (60 %) et Twitter (57 %). Là encore, les journalistes travaillant pour des sites d’information ont tendance à utiliser davantage ces
moyens de promotion que les autres. Une variable importante concernant Twitter est l’expérience dans le métier : plus de 60 % des journalistes qui ont une expérience de moins de 20 ans
l’utilisent pour faire la promotion de leur travail, alors qu’ils sont moins de la moitié de ceux qui ont une expérience de plus de 20 ans à faire de même. Le même biais est observable quand
il s’agit de mesurer la crédibilité accordée par les journalistes à l’information trouvée dans les réseaux sociaux : globalement, les plus jeunes et ceux qui travaillent pour des sites web
tendent à accorder plus de crédibilité à ces informations. Même s’il n’existe pas encore des données précises en ce qui concerne d’autres pays quant à l’usage que les journalistes font de
Twitter, il semble bien que la tendance soit similaire, au moins en ce qui concerne la messagerie instantanée (Boczkowski, 2010). UN (FUTUR) GÉANT AUX PIEDS D’ARGILE ? Au vu de la croissance
exceptionnelle du nombre de ses utilisateurs, Twitter est visiblement promis à un bel avenir, et ce d’autant que Facebook, son principal concurrent, malgré une avance considérable, semble
aujourd’hui en difficulté, les controverses de plus en plus fréquentes autour de l’exploitation commerciale des données personnelles de ses membres risquant de provoquer la désaffection d’un
certain nombre d’utilisateurs au profit d’autres réseaux sociaux comme Twitter. Cependant, Twitter est lui aussi susceptible de rencontrer un certain nombre de problèmes. Tout d’abord, à
l’instar de Google et de Facebook, son succès peut progressivement ternir l’image positive que le service a su se créer, comme en témoigne par exemple la polémique qu’a soulevée la prétendue
censure des messages relatifs à l’attaque de l’armée israélienne contre la flottille qui se dirigeait vers Gaza le 31 mai 2010. De telles polémiques, justifiées ou non, peuvent pousser les
utilisateurs les plus soucieux d’éviter une éventuelle censure ainsi que l’exploitation marchande de leurs données personnelles vers des réseaux _open source_ ou complètement décentralisés,
comme Identi.ca ou Diaspora. Cependant, la menace la plus sérieuse pour Twitter est la fragilité de son infrastructure technique et de son modèle économique. Twitter a grandi trop vite, ce
qui a obligé ses créateurs à entrer dans un processus de réajustement permanent de l’infrastructure technique au regard des centaines de milliers d’utilisateurs arrivant tous les jours sur
le réseau. Les ajouts successifs de couches logicielles et infrastructurelles ont abouti à un système d’information qui ressemble à un patchwork instable menaçant de s’effondrer à chaque
surcharge significative — en témoignent les nombreuses pannes et mises hors service qui émaillent son fonctionnement quotidien. S’ils veulent répondre efficacement à la demande, ses
responsables devront probablement procéder dans un futur proche à une vaste réorganisation technique, non exempte de difficultés de mise en œuvre. Le deuxième pari de Twitter réside dans la
mise en place d’un modèle économique viable : malgré son succès en matière d’audience, ses recettes demeurent insignifiantes. La stratégie jusqu’alors adoptée ressemble fort à celle employée
par Google : créer d’abord une base d’utilisateurs pour lesquels on devient indispensable, essayer ensuite de la monétiser. La première étape a été un succès ; la deuxième est en cours de
gestation. Il s’agira probablement d’un modèle mixte, avec une forte composante de financement indirect, publicitaire et marketing. Les deux principales pistes avancées par Twitter sont
d’une part la création d’un système de _tweets_ sponsorisés qui s’intégreront dans les résultats du moteur de recherche et, d’autre part, la création d’un système de commissions versées par
des tiers qui exploitent le service à des fins publicitaires. Dans un marché publicitaire en crise et largement dominé par Google, l’avenir seul montrera dans quelle mesure cette voie sera
efficace. DONNÉES CLÉS * DIRECTION DE TWITTER : Jack Dorsey (Président), Evan Williams (Directeur Général) * CHIFFRE D’AFFAIRES : * VALORISATION : 8 milliards $ * NOMBRE D'UTILISATEURS
: 200 millions * NOMBRE DE TWEETS ÉCHANGÉS PAR JOUR : 340 millions * NOMBRE D’EMPLOYÉS : plus de 600 * SIÈGE SOCIAL : San Francisco, Californie BIBLIOGRAPHIE * Albert-László BARABASI,
(2002), _Linked: The New Science of Networks_, Basic Books, New York. * Pablo Javier BOCZKOWSKI, « Ethnographie d'une rédaction en ligne Argentine. Les logiques contraires de la
production de l'information chaude et froide », _Réseaux _n° 160, 2010/2-3, p. 43-78. * Dominique CARDON, (2005), « Innovation par l’usage », in Alain Ambrosi, Valérie Peugeot et Daniel
Pimienta (dir.), _Enjeux de mots : regards multiculturels sur les sociétés de l’information_, C & F Éditions, Caen. * Cha Meeyoung, Haddadi Hamed, Benevenuto Fabricio, Gummadi Krishna
P., (2010), « Measuring User Influence in Twitter : The Million Follower Fallacy », _Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 4th International Conference on Weblogs and
Social Media_, May 23-26, George Washington University, Washington, DC. * Fabien GRANJON et Aurélien LE FOULGOC, « Les usages sociaux de l’actualité. L’expérience médiatique des publics
internautes », _Réseaux_ n° 160, 2010/2-3, p. 225-253. * Bill HEIL, Mikolaj PISKORSKI, 2009, « New Twitter Research: Men Follow Men and Nobody Tweets », Working Paper, _Harvard Business
School_. * Bernardo A. HUBERMAN, Daniel M. ROMERO, Fang WU, (2009), « Social networks that matter: Twitter Under the microscope », _First Monday_,Volume 14, Number 1 - 5 January. * Akshay
JAVA, Tim FININ, Xiaodan SONG, Belle TSENG, (2007) « Why We Twitter: Understanding Microblogging Usage and Communities », _9th WebKDD and 1st SNA-KDD workshop on Web mining and social
network analysis_, August 12, San Jose, California. * Elihu KATZ, Paul LAZARSFELD, _Personal Influence_, The Free Press, New York, 1955. * Balachander KRISHNAMURTHY, Phillipa GILL, Martin
ARLITT, (2008), « A few chirps about twitter », _1st ACM SIGCOMM Workshop on Social Networks_, Seattle, WA, August 2008. * Haewoon KWAK, Changhyun LEE, Hosung PARK, Sue MOON, (2010), « What
is Twitter, a Social Network or a News Media? », _19th International World Wide Web Conference_, April 26-30, Raleigh NC (USA). * Maarit MAKINEN, Mary Wangu KUIRA, (2008), « Social Media and
postelection Crisis in Kenya », _The International Journal of Press/Politics_, 13 (3), p. 328-335. * Turo USKALI, (2009), « Weak Signals in Innovation Journalism – Cases Google, Facebook
and Twitter », _Innovation Journalism_, vol.6, n°6.