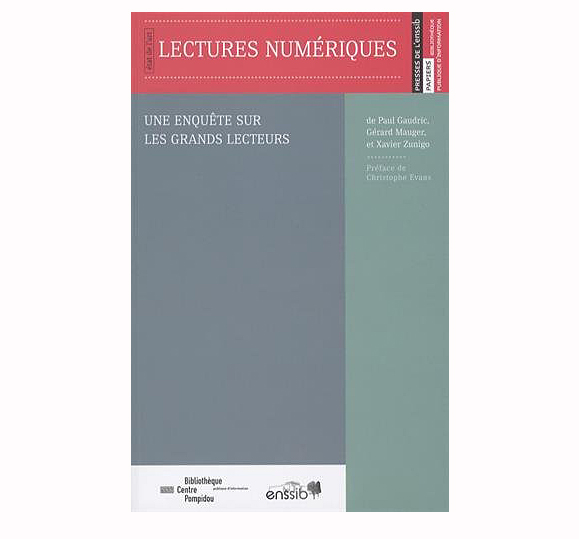
- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
La révolution numérique a certes favorisé l’apparition de nouvelles façons de lire, mais pas pour tous les lecteurs, ni pour tous les contenus. Louis Wiart Publié le 04 mars 2019 L’évolution
des pratiques de lecture numérique est observée régulièrement et scrupuleusement par des organes professionnels et des instituts de sondages, dont les enquêtes se situent principalement
dans une perspective quantitative liée à des objectifs de mesure. En complément à ces travaux qui ont eu tendance à se multiplier en même temps que les secteurs du livre et de l’écrit se
confrontaient à l’enjeu du numérique, d’autres projets de recherche ont émergé ces dernières années1 avec l’ambition de porter un regard différent sur le phénomène et de donner plus de poids
à l’expérience des individus. L’enquête dont est issu l’ouvrage _Lectures numériques_ en fait partie. A partir d’entretiens approfondis auprès de grands lecteurs dont de longs extraits sont
donnés à lire, les sociologues Paul Gaudric2, Gérard Mauger3 et Xavier Zunigo4 cherchent à appréhender les effets des bouleversements technologiques en cours sur les habitudes du lectorat.
Identifiant plus de permanences que de ruptures, l’analyse développée montre que les incidences du numérique dépendent du type d’usage associé à la lecture, en particulier du fait de lire
des informations ou de la littérature. LE PAPILLONNAGE INFORMATIONNEL La conversion de la presse au numérique s’est accompagnée d’une série de transformations d’envergure, parmi lesquelles
figurent le recul du format imprimé, le bouleversement des modèles économiques, l’arrivée de nouveaux entrants dans le champ de l’information écrite ou encore l’émergence d’un « journalisme
amateur ». Dans ce contexte, le domaine de la presse écrite est celui pour lequel les pratiques de lecture ont connu les changements les plus significatifs. Les lecteurs se mettent à accéder
à un flux continu d’informations en permanence, modifient leur manière de lire à travers une navigation de liens en liens et diversifient les ressources consultées. > Le domaine de la
presse écrite est celui pour lequel les pratiques > de lecture ont connu les changements les plus significatifs Si les légitimités et les hiérarchies entre sources d’information ne sont
pas affectées par le numérique, ainsi que la distribution sociale des intérêts et des goûts, les modalités de lecture tendent à se fragmenter dans l’espace et dans le temps. C’est ainsi que
la façon de lire privilégiée par les personnes interrogées dans l’étude correspond à un balayage quotidien de la presse en ligne, assimilable à une forme de « papillonnage informationnel »,
marqué par un usage presque compulsif des terminaux de lecture pour remplir des temps morts. Un apprentissage et une adaptation sont nécessaires de la part des lecteurs, qui peuvent
ressentir un sentiment de submersion et d’addiction face aux outils numériques. Plus que d’autres, certaines catégories de lecteurs ont stabilisé leurs usages et développés des compétences
spécifiques dans la consultation des sites. L’enquête propose un focus sur deux profils d’usagers intensifs des médias numériques : ceux qui exercent des métiers politiques et qui se
tiennent au courant de l’actualité en transposant vers un nouveau support leurs pratiques issues de la presse écrite, et ceux qui évoluent dans le secteur de l’informatique et dont les
logiques de navigation s’appuient sur l’importation de leur savoir-faire au domaine de l’information. Selon les sociologues, l’écart observé entre les habitudes de ces lecteurs _« _reflète
l’état actuel de la presse numérique, dont la définition et les pratiques ne sont pas encore figées, et qui voient s’affronter des logiques économiques issues du fonctionnement, d’une part
des entreprises de la presse classique, d’autre part des entreprises venues du Web _»._ LA PERMANENCE DES PRATIQUES DE LECTURE LITTÉRAIRE Depuis la seconde moitié des années 2000, le champ
de l’édition de livres connaît une accélération du mouvement en direction du numérique en raison de l’essor de l’Internet et de l’informatique grand public, de la mise au point de supports
de lecture adaptés à des prix accessibles et du positionnement sur le marché de géants du web comme Google, Apple et Amazon. Il semble que la numérisation de la filière ne touche pas tous
les domaines éditoriaux de la même façon, les textes pour lesquels l’informatisation des usages apporte le plus de valeur ajoutée par rapport au format imprimé, comme la littérature
professionnelle ou universitaire, se signalant par un passage au numérique bien plus précoce. Aujourd’hui, 20 % de la population française déclare avoir déjà lu un e-book selon la dernière
édition du baromètre du livre numérique, mais l’augmentation du nombre de ces lecteurs s’accompagne d’une faible croissance du marché > 20 % de la population française déclare avoir déjà
lu un e-book En dépit des transformations à l’œuvre dans le secteur, l’analyse livrée dans l’étude relève une permanence des pratiques de lecture littéraire, qui s’inscrivent très largement
dans la continuité des habitudes antérieures du lectorat. Comme le soulignent les auteurs, « les pratiques et les outils numériques proposés ne sont pas encore suffisamment stabilisés et
optimisés pour détrôner le papier, mais surtout pour rebattre les cartes des logiques sociales et de leur influence sur les pratiques de lecture ». Les effets les plus notables de la lecture
numérique se limitent pour l’essentiel aux dimensions techniques des nouveaux supports, liés à des avantages d’ordre pratique en termes d’accès, de confort (légèreté, maniabilité, etc.), de
stockage ou encore de mobilité. D’un autre côté, les sociologues observent la montée en puissance de nouveaux modes de prescription, qui tendent à glisser depuis les prescripteurs
traditionnels (médias, libraires, bibliothécaires, entourage, etc.) vers des formes de médiation numérique (blogs, réseaux sociaux, forums, moteurs de recommandation, statistiques d’usage,
etc.). En d’autres termes, la transition numérique engagée dans le domaine littéraire provoquerait actuellement moins de conséquences sur les pratiques de lecture en tant que telle que de
changements institutionnels en bouleversant « les circuits économiques de l’édition par la concurrence de nouvelles entreprises et la possibilité pour les lecteurs de s’émanciper des
circuits classiques de distribution pour aller vers le libre et/ou le gratuit ». DE LA CULTURE AUDIOVISUELLE À LA CULTURE NUMÉRIQUE ? Loin des discours enthousiastes des laudateurs des
nouvelles technologies, le présent ouvrage permet d’identifier les permanences et de circonscrire les ruptures induites par le numérique dans les habitudes du lectorat. L’enquête qualitative
conduite auprès de grands lecteurs permet de saisir la variété des pratiques de lecture numérique tout en insistant sur le caractère limité des transformations observées à l’heure où lire
sur un écran devient une activité ordinaire. Plus que le support de l’écrit, il semble que ce soit l’usage attendu de la lecture qui joue un rôle décisif. À la lecture linéaire et
progressive que l’on retrouve dans le champ de la littérature, répond la lecture fragmentaire et discontinue constatée pour la presse écrite, qui s’accommode mieux du phénomène de zapping
numérique hérité de l’audiovisuel. Car s’il est possible d’envisager l’existence d’une « révolution culturelle », les auteurs de l’étude pensent que celle-ci est antérieure à la « révolution
numérique », qui étend au domaine de l’écrit les conséquences de la « révolution audiovisuelle » et associe au texte du son et de l’image. De ce point de vue, les pratiques de lecture
numérique seraient en fait marquées par l’articulation entre culture de l’écrit et culture audiovisuelle. * 1Voir par exemple, Françoise PAQUIENSÉGUY, Mathilde MIGUET, Le lectorat numérique
aujourd’hui : pratiques et usages, Éditions des archives contemporaines, 2015. * 2En activité dans divers bureau d’études et organismes publics d’évaluation. * 3Directeur de recherche
émérite au CNRS et chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (CNRS – EHESS – Paris 1). * 4Co-directeur de l’agence de recherche et d’ingénierie statistique et
qualitative (ARISTAT).







