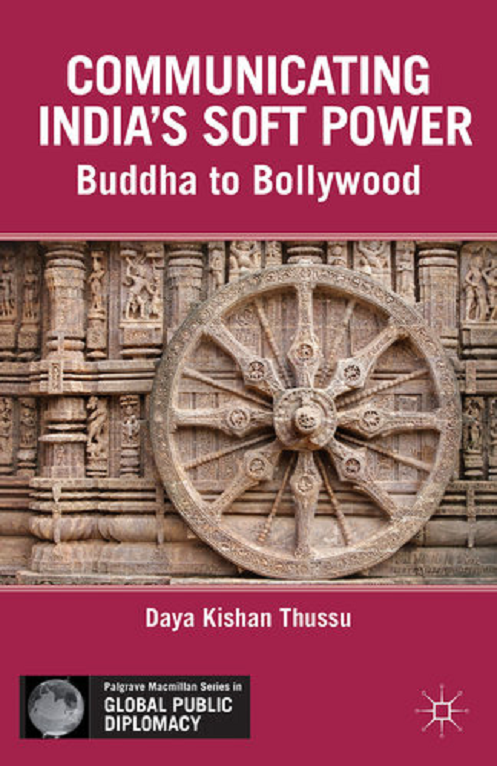
- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
Daya Kishan Thussu, professeur à l'université de Westminster, signe un fervent plaidoyer pour le rayonnement de l'Inde sur la scène internationale. Mais la popularité des films
Bollywood suffit-elle pour parler de soft power ? Hélène Lecuyer Publié le 04 mars 2019 Pour Joseph Nye, analyste en géopolitique spécialisé dans les relations internationales, le concept de
_soft power_ – parfois traduit en français par « puissance douce » bien que le terme anglo-saxon lui soit souvent préféré – est la capacité qu’une nation a d’influencer les autres par le
biais de la diffusion de ses valeurs, de sa culture et ce grâce à l’appui de la société civile. On oppose généralement au concept de _soft power_ celui de _hard power_, la capacité qu’a une
nation d’imposer ses vues et d’obtenir des autres nations des décisions qui lui seront favorables, principalement au moyen de sa puissance militaire. Daya Kishan Thussu, professeur en
communication internationale à l’université de Westminster (Londres), et fondateur et rédacteur en chef de la revue _Global Media and Communication_ en est convaincu : en termes de _soft
power_, l’heure de l’Inde a sonné. Dans son ouvrage _Communicating India’s soft power, Buddha to Bollywood_, il entreprend de relever de manière systématique tous les éléments qui permettent
d’annoncer l’avènement de ce nouveau _soft power_. > L'auteur veut désaméricaniser le concept de soft power. Pour lui, il convient tout d’abord de désaméricaniser ce concept,
inventé par Joseph Nye pour refléter la formidable capacité qu’ont les Américains à intéresser et influencer le reste du monde, l’amenant à adopter les valeurs américaines grâce à la
puissance de leur réseau de communication, à leur formidable industrie culturelle et à leur main-mise sur Internet. Si le modèle américain du _ soft power_ a été très largement efficace,
permettant aux États-Unis de gagner la guerre froide, l’étroitesse de son point de vue devient un handicap dans le contexte de la globalisation et des fluctuations qu’entrainent un
multiculturalisme et un multilinguisme croissant. Exit les États-Unis, du moins Thussu semble l’espérer. Place à l’Inde que son passé, ses valeurs préparent tout naturellement à un rôle de
leader dans ce nouveau monde, et ce notamment puisque sa résurgence économique lui accorde un nouveau statut sur la scène internationale. Thussu rappelle la position singulière de l’Inde, un
pays qui n’a cessé d’influencer et d’être influencé et qui de par son histoire a la particularité de mêler à la fois de solides fondations hindouistes et bouddhistes, l’héritage islamique
des anciennes invasions mongoles et qui a su intégrer les institutions et idées européennes qui lui ont été imposées au temps de l’impérialisme britannique. Quel autre pays pourrait dès lors
être plus à même d’aborder le XXIème siècle, siècle d’un monde globalisé, complexe, divers ? Thussu en veut pour preuve la popularité croissante à l’international de la cuisine indienne,
des films Bollywood, la visibilité de l’art et de la littérature, la façon dont la spiritualité indienne a su conquérir l’Occident via le yoga et le mouvement « New Age ». C’est une première
critique qu’on pourrait d’ailleurs adresser à l’auteur. Avec rigueur, l’auteur entreprend un catalogue systématique de toutes les manifestations de l’Inde sur la scène internationale, que
ce soit la nomination d’un PDG d’origine indienne à la tête d’un grand groupe américain ou l’insertion d’une chanson Bollywood dans le film _Moulin Rouge_. Cette avalanche de données
empiriques, aussi exacte soit-elle, constitue-t-elle vraiment la manifestation d’un _soft power_ ? > Il ressort plutôt que ce soft power indien se développe surtout à > l’insu des
pouvoirs publics qui ne cherchent pas à en tirer > avantage. L’ouvrage tourne parfois à l’abécédaire sans qu’il soit possible de discerner vraiment si la présence croissante de l’Inde,
que ce soit dans les sphères politiques, économiques, culturelles, constitue autre chose qu’une simple visibilité. Où est l’influence ? L’auteur s’étend longuement sur l’héritage de Bouddha
– qui ne fut cependant pas prophète en son pays – ainsi que sur celui de Mahatma Gandhi. Si le _soft power_ est la manifestation de la capacité d’un pays à influencer les relations
internationales afin qu’elles lui soient favorables, l’auteur peine cependant à démontrer concrètement comment l’Inde a pu, ou su, en bénéficier dans un passé récent. À la lecture de
l’ouvrage, il ressort plutôt que ce _soft power_ se développe surtout à l’insu des pouvoirs publics qui ne cherchent pas à en tirer avantage. Bien sûr, l’industrie de Bollywood constitue la
manifestation la plus éclatante du _ soft power_ indien. Cette industrie valait 12,5 milliards de dollars en 2012. Ce chiffre d’affaires peut sembler modeste mais les volumes sont énormes.
Forte de ses 1 000 longs métrages produits annuellement et s’appuyant sur un marché domestique de 1,2 milliard d’habitants, Bollywood vend chaque année un milliard de tickets d’entrée de
plus que Hollywood. Une anecdote rapportée dans l’ouvrage est celle du journaliste Bobby Ghosh, ancien chef de bureau à Bagdad pour le _Time magazine_. Ghosh relate comment Bollywood lui a
sauvé la vie. Alors qu’il était tenu sous la menace d’une arme par un soldat fidèle à Saddam Hussein, il a su désamorcer une situation critique en se déclarant « Indien …. Comme Shammi
Kaboor »(1). Si la visibilité de Bollywood à l’Ouest se résume encore trop souvent à son seul nom, évocateur de danses et de chansons, il existe une vrai popularité et une industrie d’export
dans toute l’Asie du Sud, au Moyen Orient, en Afrique, en Russie même, et l’auteur de répertorier de manière quasi systématique tous les marchés de niche de Bollywood et les nouveaux qui
s’ouvrent par exemple en Chine, avec le succès au box-office d’un film comme _The Three Idiots_. > L’auteur déplore la vision distordue de l’Inde que véhicule > Bollywood. Il faut
aussi mentionner les investissements croisés entre Hollywood et Bollywood, en développement exponentiel grâce à la politique « néo-libérale » du gouvernement indien, Hollywood espérant
conquérir le marché indien, comme le montre le développement du doublage même en langues régionales tandis que Bollywood s’attaque à Hollywood via par exemple les investissements massifs de
Reliance dans DreamWorks. L’auteur déplore cependant la vision distordue de l’Inde que véhicule Bollywood, l’industrie faisant trop souvent l’impasse des sujets économiques et sociaux pour
privilégier bluettes et autres films romantiques décrivant les péripéties des Indiens dans les capitales occidentales, pour le plus grand bonheur du public issu de la diaspora. Car l’atout
principal de ce _soft power_ réside sans nul doute dans la diaspora indienne. L’auteur évoque longuement le rôle joué par la communauté de personnes d’origine indienne aujourd’hui disséminée
autour du globe mais connectée plus que jamais entre elles et à leur pays d’origine grâce à la technologie et particulièrement aux médias sociaux. Cette diaspora de plus de 25 millions de
personnes, la plus grande au monde après la diaspora chinoise, se manifeste par une visibilité croissante à haut niveau, dans le monde des affaires, celui des médias, celui des nouvelles
technologies, le monde universitaire (l’actuel président de la Harvard Business School notamment est d’origine indienne : Nitin Nohria). Cette diaspora d’une élite intellectuelle contribue à
créer une image positive de l’Inde et par sa présence active sur les médias sociaux, particulièrement lorsqu’il s’agit de débattre de questions liées à l’Inde, elle exerce une influence
disproportionnée dans la perception de l’Inde sur la scène internationale. La diaspora indienne, qui trouve sa source dans l’impérialisme et notamment le besoin de main d’œuvre de l’économie
anglaise après la Seconde Guerre mondiale correspond à la fois à une émigration populaire, celles des travailleurs qui s’exilent sur les chantiers du Moyen-Orient et à une émigration
d’élite, celle des cerveaux, que le gouvernement indien a longtemps qualifié de fuite alors que la classe moyenne et supérieure indienne envoyait dès qu’elle le pouvait ses enfants étudier
au Royaume-Uni ou aux États Unis. Aujourd’hui pourtant, les pouvoirs publics indiens parlent plutôt de « circulation des cerveaux » et par une politique de citoyenneté favorable – qui a
permis notamment la création d’une « citoyenneté d’outremer »(2) encouragent le retour de ces enfants perdus. Quel que soit son niveau social cependant, cette diaspora se caractérise par le
maintien des liens communautaires, l’entretien d’un collectif culturel via les festivals, la consommation de musique ou de cinéma qui font perdurer le sentiment d’attachement à la patrie
d’origine. Daya Kishan Thussu est d’ailleurs lui-même un enfant de cette diaspora. En cela, il est caractéristique lui aussi d’une certaine vision fantasmée de l’Inde – et ce en dépit de la
rigueur académique indéniable de son ouvrage. C’est une tendance courante parmi les membres de la diaspora, ou même parmi les plus éduqués de la population indienne, de relever longuement
les atouts de l’Inde, les apports par ailleurs indéniables que sa civilisation a amené dans l’histoire, comme l’invention du nombre zéro, une information que les Indiens aiment à rappeler à
leurs visiteurs étrangers. Cette tendance est peut-être révélatrice d’une certaine frustration, alors que l’Inde ne semble toujours pas occuper sur la scène internationale un rôle
proportionnel à son importance. On retrouve souvent chez ces enfants de la diaspora une vision idyllique de la patrie d’origine. > On retrouve souvent chez ces enfants de la diaspora une
vision > idyllique de la patrie d’origine. Un écueil que n’évite pas Thussu lorsqu’il évoque par exemple le pacifisme légendaire de l’Inde – une information que dément trop souvent
l’actualité alors que les conflits avec le Pakistan et la Chine ne se sont jamais vraiment apaisés, que l’armée indienne est avec 1,3 million de soldats la troisième armée au monde et que
l’Inde ne cesse de renforcer son arsenal nucléaire. Ou encore lorsqu’il parle de la tolérance indienne légendaire, qui pourrait selon lui contribuer à faire évoluer la vision de l’Islam trop
souvent assimilé au risque terroriste depuis les attentats de 2002. C’est sans compter la montée du nationalisme, comme démontré par la victoire du parti ultra-nationaliste hindou aux
dernières législatives et la nomination de Narendra Modi (ci-contre) à la tête du pays. Il existe indéniablement en Inde une montée du communautarisme et du sentiment anti-musulman. D’autre
part, Thussu vante l’extraordinaire liberté dont jouissent les intellectuels indiens. C’est oublier un peu vite la censure, dont la dernière illustration est la confirmation par la police du
Mharashtra que « liker » sur les réseaux sociaux des contenus controversés – c’est-à-dire susceptibles d’offenser les convictions historiques, religieuses, politiques – était bien passible
de prison. Il n’en reste pas moins vrai que dans de nombreux domaines culturels, que ce soit le monde des médias, le monde universitaire, la culture populaire, il existe une présence
indienne à l’international et que celle-ci se renforce. Faut-il pour autant parler de _soft power _au sens où l’entendait Joseph Nye ? Le _soft power_ indien va-t-il vraiment détrôner le_
soft power_ américain ? En l’absence d’une véritable politique publique visant à l’exploiter, et alors que le gouvernement indien est confronté à des enjeux gigantesques dans ses frontières
intérieures, l’ouvrage de Daya Kishan Thussu prend parfois des allures de plaidoyer. À LIRE ÉGALEMENT : -- Crédits photo : Joseph Nye (Chatham House / Flickr)







