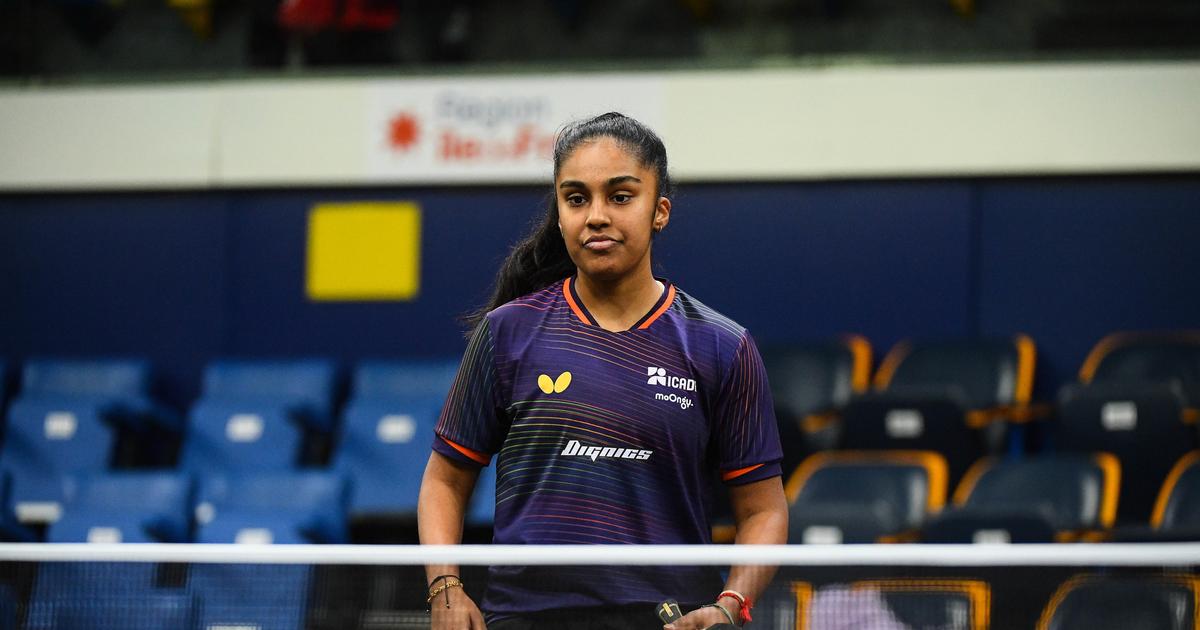- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
© Crédits photo : Fespaco. GROS PLAN SUR LES CINÉMAS AFRICAINS - ÉPISODE 4/5 Né en 1969, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est parvenu à devenir
un événement incontournable mais celui-ci peine à concrétiser ses objectifs pour le cinéma africain. Maria Masood Publié le 21 mars 2013 Crée en 1969, le festival panafricain du cinéma et de
la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est devenu un évènement incontournable des cinémas africains. Bisannuel depuis 1979, le festival se donne un triple objectif de diffusion des films
africains, de promotion des échanges entre les professionnels et, enfin, de participation au développement et à la préservation du cinéma du continent « en tant que moyen d'expression,
d'éducation et de conscientisation ». Y parvient-il ? LE FESPACO, UNE FÊTE DU CINÉMA La première édition du festival réunit cinq pays africains autour de 24 films présentés à une
dizaine de milliers de spectateurs. 44 ans plus tard, le cru 2013 compte 169 films, dont une centaine en compétition, et accueille plusieurs centaines de milliers de festivaliers. 35 pays,
africains et occidentaux, ont été représentés cette année face à un jury de 27 membres dont 14 femmes mises à l’honneur. La distinction la plus haute du Fespaco – l’étalon d’or de Yennenga,
qui s’accompagne d’un trophée ainsi que d’une cagnotte de 10 millions de FCFA (15 245 euros) – a été décernée au film _Tey_ (_Aujourd’hui_) du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis,
sélectionné parmi les 19 films présentés dans la catégorie long-métrage. Outre les prix traditionnels récompensant le scénario, les acteurs ou encore le montage, la biennale est aussi
l’occasion de mettre en avant des thématiques chères aux différents acteurs du continent, et plus particulièrement du secteur de la coopération, à travers la remise d’une vingtaine de prix
spéciaux. Ce sont ainsi 24 prix qui ont été décernés cette année en l’honneur de la promotion des droits de la femme, du développement durable, de la paix, des droits de l’homme, etc. Ces
prix, d’une valeur moyenne de 5 millions de francs CFA, sont financés et décernés par des institutions internationales et régionales, des médias, des collectivités mais aussi par des
fondations privées_. _Au rang des derniers-nés, notons que la 23ème édition a accueilli un prix spécial intitulé « Afrikenous », d’un montant de 4 millions de francs CFA (environ 6 100
euros) et décerné par la Maison de l’Afrique-Madingo, représentant la diaspora africaine installée au Canada, afin de récompenser le cinéaste qui aura réussi à présenter une facette plus
joyeuse et positive de l’Afrique et à « rejeter l’afro-pessimisme ». Initiative intéressante lorsque l’on sait que les détracteurs du _world cinema_ estiment que le succès d’un film du Sud
sur la scène internationale passe par une nécessaire dénonciation des maux et travers de la société. UN ÉVÉNEMENT POPULAIRE Au delà de la promotion des cinémas africains, le Fespaco est un
véritable évènement populaire attirant un grand nombre de burkinabés aux différentes activités organisées en marge des projections cinématographiques : les galeries marchandes, gérées par
l'Agence pour la promotion des exportations (ex-Office national du commerce), le village artisanal ou encore les « Nuits musicales » sont autant d’occasions pour les festivaliers de se
réunir en dehors des salles obscures. Ainsi, selon Colin Dupré, « l’aspect populaire du Fespaco ne se situe pas toujours au niveau du cinéma, […] c’est à la Rue Marchande que les Ouagalais
aiment faire leur Fespaco ». Afin de favoriser une participation massive de la population, le gouvernement burkinabé a par ailleurs mis en place des journées de travail continues de 7h à 14h
dans la commune de Ouagadougou. Malheureusement, il n’existe pas de statistiques fiables portant sur la fréquentation du festival. Certaines estimations évoquent le chiffre, difficile à
vérifier, d’un demi-million de festivaliers lors des précédentes éditions. Les cérémonies d’ouverture et de clôture du festival, organisées au stade du 4 août, sont également des moments
phares de la biennale où le public se réunit en masse. Cette année, c’est le groupe ivoirien Magic System, très populaire au Burkina Faso, qui a assuré le spectacle lors de la cérémonie de
remise des prix face à plus de 20 000 spectateurs. Attirant un grand nombre de festivaliers, le Fespaco entraîne des retombées économiques non négligeables pour Ouagadougou. Selon le
ministère burkinabé de la Culture, du Tourisme et de la Communication, ce sont plus de 450 personnes qui travaillent à l’organisation du festival. À cela s’ajoutent les effets indirects : la
quarantaine d’hôtels que compte la ville affichent complets durant cette période et certains habitants profitent même de l’occasion pour transformer leurs habitations en chambres d’hôtes_.
_Bien que les études existantes sur l’impact économique du Fespaco soient relativement anciennes (la dernière en date a été réalisée en 1995 à l’initiative de l’Union européenne), elles
soulignent les retombées très positives pour les commerçants de la ville et pour le secteur du tourisme, et plus particulièrement pour l’hôtellerie, la restauration et les sociétés de
transport. Selon l’étude de l’Union européenne, dont les estimations sont à considérer avec beaucoup de précautions(1), le Fespaco aurait ainsi permis de générer 1,63 milliards de francs
CFA. UN FESTIVAL EN PLEINE ÉVOLUTION ? Souvent critiqué pour ses dysfonctionnements et son organisation approximative, le comité d’organisation semble avoir pris en compte certaines
critiques récurrentes faites à son encontre et particulièrement virulentes lors du dernier Fespaco. Une évaluation, réalisée en 2010, avait révélé les nombreux dysfonctionnements liés à
l’organisation du festival et proposait une série de recommandations à l’égard du comité d’organisation mais aussi de ses partenaires. Il est ainsi arrivé lors des précédentes éditions que
certains invités, dont d’éminentes figures du cinéma africain, se retrouvent sans hébergements, voire sans billets d’avion, ou encore qu’un certain nombre de films en compétition aient été
supprimés au cours de la manifestation, autant d’éléments symbolisant pour certains « l’amateurisme » du comité d’organisation. Outre l’adoption d’un projet de renforcement des capacités
suite aux résultats de cette évaluation, un certain nombre de mesures semblent avoir déjà été mises en œuvre. Par exemple, la délégation de l’Union européenne au Burkina Faso, principal
bailleur extérieur du festival, s’est engagé à décaisser son soutien financier en amont de la manifestation. En effet, il semblerait que le retard de paiement de sa contribution lors des
précédentes éditions ait contribué aux difficultés organisationnelles du festival. Autre illustration : l’obligation pour les films présentés d’être en 35mm se traduit à chaque édition, par
l’élimination de certains films de la compétition (cette année, ce sont les films de Merzak Allouache et Flora Gomes qui ont notamment été supprimés). Régulièrement, la pertinence de ce
critère est remise en question face à la numérisation croissante de la filière et au coût élevé du kinescopage (opération qui consiste à transférer un film numérique sur un support
argentique) dans un contexte de rareté des ressources financières. Pour répondre à ces critiques, Michel Ouédraogo, directeur général de la 23ème édition du Fespaco, a d&eacueacute;claré
que la prochaine édition de la biennale accueillerait des films numériques, ce qui représente un véritable tournant pour le Fespaco et les jeunes cinéastes souhaitant y participer. UNE
RECONNAISSANCE DES TALENTS NÉCESSAIRE Bien qu’il n’existe pas de dispositif de suivi des anciens lauréats des étalons de Yennenga (plus hautes récompenses du Fespaco), le rôle du festival
dans la promotion des talents du continent semble avéré. Le Fespaco représente ainsi l’une des rares occasions d’offrir une reconnaissance professionnelle aux cinéastes africains. En outre,
la biennale bénéficie d’une certaine couverture médiatique qui permet une meilleure visibilité des films et réalisateurs en compétition tant au niveau local qu’à l’international. Lors de
cette 23ème édition, plus de 3 000 accréditations ont été accordées, un chiffre en augmentation constante au fil des années. Enfin, de nombreux programmateurs de festivals étrangers se
déplacent à la biennale afin d’y sélectionner des films : en 2009, ils étaient près d’une centaine. À cet égard, le Fespaco apparaît comme un tremplin pour la diffusion des films africains à
l’étranger, mais celle-ci demeure pour l’essentiel restreinte aux festivals. Très peu de films africains parviennent en effet à franchir les frontières de leur pays d’origine, même
lorsqu’ils ont été primés dans le cadre du Fespaco. UN MARCHÉ ENCORE PEU DÉVELOPPÉ Crée en 1983 afin de stimuler le marché cinématographique du continent, le Marché international du cinéma
africain (MICA) est un lieu de rencontres entre les professionnels de différents pays africains mais aussi d’Europe et du continent américain. Le MICA s’apparente à une bourse de programmes
audiovisuels et permet ainsi aux cinéastes de rencontrer les acheteurs, les programmateurs de festivals, les télévisions et les distributeurs. Cette année, 104 films étaient inscrits au
MICA. Toutefois, il semblerait que l’affluence ait été moindre, confirmant la diminution amorcée lors des précédentes éditions. Si l’on suit l’analyse des professionnels de ce secteur, ce
déclin n’est que le reflet de la réalité du cinéma et de l’audiovisuel en Afrique où le parc de salles est en très nette diminution, et où les chaînes de télévision ne jouent pas le rôle de
levier sur la production cinématographique tandis que la consommation audiovisuelle est largement dominée par le piratage des œuvres. _Affiche du film Ouaga Saga, réalisé par Dani Kouayté et
présenté au Fespaco en 2005_ DE L’INÉVITABLE QUESTION DES SOURCES DE FINANCEMENT La question du financement étant un élément crucial pour l’existence des cinémas africains, le festival est
également l’occasion pour les cinéastes de rencontrer les acteurs de la coopération culturelle que sont l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), le Centre national de la
cinématographie (CNC), le programme ACP Culture Plus de l’Union européenne et l’Unesco. Lors de cette édition, plusieurs représentants de ces institutions avaient fait le déplacement afin de
présenter leur programme de soutien et les modalités de candidature. Ainsi, le CNC a pu présenter son nouveau programme d’aide « cinémas du monde », remplaçant l’ancien Fonds Sud, avec un
budget annuel augmenté s’élevant à 6 millions d’euros, destiné aux cinéastes du monde entier (et non plus seulement des pays dits « du Sud »). De façon inédite, un fonds « panafricain » a
également été présenté lors de la biennale. En effet, depuis près de 50 ans, ce sont les institutions du Nord qui fournissent l’essentiel de l’effort financier à la production des films
africains. Parallèlement, le souhait des cinéastes du continent de pouvoir s’appuyer sur une coopération Sud-Sud a conduit à la création en 2012 du Fonds panafricain pour le cinéma et
l’audiovisuel (FPCA). Le FPCA se définit comme un partenariat public-privé interétatique qui vise à développer un véritable programme _africain_ de soutien au 7ème art du continent. Selon
Férid Boughedir, ancien président du jury du Fespaco et actuellement coordinateur et président du comité d’orientation provisoire du FPCA, « ce Fonds panafricain du cinéma répond à ce vieux
rêve qu’à la coopération Nord-Sud on ajoute la coopération Sud-Sud. (…) Le projet a toujours un côté utopique. Ce pari c’est de pouvoir faire une sorte de solidarité cinématographique entre
les pays africains nantis économiquement et ceux qui sont moins nantis. Le fonds sera ouvert à des bailleurs de fonds de partout : européens, des fondations etc. ». Le FPCA, dont les statuts
et le siège n’ont pas encore été définis, devra se confronter à un double défi d’envergure : obtenir un soutien concret des différents États et institutions du continent (notamment l’Union
africaine) et parvenir à rassembler les professionnels du cinéma qui ont montré à maintes reprises leur difficulté à s’organiser dans le cadre de la FEPACI (Fédération panafricaine des
cinéastes). L’INTERPELLATION DES POUVOIRS PUBLICS Chaque biennale est l’occasion de rencontres et de débats entre les professionnels de l’industrie cinématographique au cours de colloques ou
d’ateliers. Le thème choisi pour la 23ème édition du Fespaco : « cinéma africain et les politiques publiques en Afrique » devait permettre selon Baba Hama, ministre burkinabé de la culture,
« d’interpeller les pouvoirs publics sur leur rôle à jouer dans la relance du cinéma africain » et « jeter les bases d’une harmonisation des politiques publiques pour le cinéma en Afrique
». Pendant deux jours, une vingtaine de personnalités politiques, des professionnels, mais aussi des représentants d’institutions internationales ou des universitaires se sont succédés afin
d’aborder les différentes problématiques du soutien aux cinémas africains. On retiendra l’intervention de Toussaint Tiendrebeogo, chargé des politiques et industries culturelles à l’OIF mais
également producteur de fllms, qui a su résumer les principaux handicaps des cinémas africains et souligner les manquements des politiques d’appui en faveur de ces derniers. Les différents
obstacles caractérisant l’industrie du cinéma africain ont ainsi été soulevés : - un manque de cohérence d’ensemble des politiques publiques : très peu d’États ont mis en œuvre des actions
en direction des différents maillons de la chaîne de valeur allant de la création à la distribution des œuvres ; - un cadre juridique peu adapté au contexte économique et juridique des pays
en question ; - des mécanismes de financement, et notamment des fonds d’aide, qui ne parviennent pas à avoir d’effet structurant sur la filière car ils ne sont pas (suffisamment) alimentés
ou le sont de façon trop discontinue ; - une forte croissance de la diffusion audiovisuelle qui ne profite pas à la production cinématographique ; - une insuffisante organisation des
professionnels du secteur ; - une forte dépendance à l’aide internationale qui n’a pas d’effet structurant sur la filière dans son ensemble mais qui permet néanmoins à certaines œuvres
d’exister. Lors du colloque, l’attention s’est également portée sur le Maroc qui semble avoir réussi ces dernières années à stimuler son industrie cinématographique notamment grâce à la mise
en œuvre d’un fonds d’avance sur recettes et à l’implication des chaînes de télévision qui auraient ainsi permis de multiplier la production annuelle du pays de 3 à 25 films en une dizaine
d’années. Suite aux débats sur la faiblesse de l’action publique et la mise en exergue des initiatives couronnées de succès, le colloque s’est conclu par la déclaration de Ouagadougou(2). Ce
texte qui s’adresse à « tous les chefs d’États d’Afrique » et à l’Union africaine s’inspire largement de l’exemple marocain et appelle à la mise en œuvre dans chaque pays africain d’un
fonds d’avance sur recettes, d’une coopération systématique avec les chaines audiovisuelles ainsi qu’un engagement fort des États auprès du FPCA. Il faudra suivre avec attention
l’application, si peu probable soit-elle, de cette déclaration initiée comme une réponse aux difficultés actuelles des cinémas africains. -- Crédits Photos : Maria Masood Affiche du film
Ouaga Saga : culturagovBr / Flickr Le réalisateur Alain Gomis : Festival de Cine Africano de Corduba / Flickr Affiche du Fespaco en 2009 : bbcworldservice / Flickr RÉFÉRENCES Colin DUPRÉ,
_Le Fespaco, une affaire d'État(s), 1969-2009_, l'Harmattan, novembre 2012 Jacques GUÈDA OUEDRAOGO, _Étude sur les retombées économiques du FESPACO_, 1995. RFI, Dossier Spécial
FESPACO 2013 Teresa HOEFERT DE TURÉGANO, _African Cinema and Europe: Close-up on Burkina Faso_, European Press Academic Publishing, 2004 Toussaint TIENDREBEOGO, _Évaluation organisationnelle
du FESPACO (2007-2009)_. 2009 GROS PLAN SUR LES CINÉMAS AFRICAINS - ÉPISODE 2/5 Le Nigeria figure parmi les producteurs de fiction les plus prolifiques du monde. Malgré des budgets
dérisoires et un niveau de qualité souvent très bas, ces films rencontrent un immense succès populaire. GROS PLAN SUR LES CINÉMAS AFRICAINS - ÉPISODE 1/5 Hors Égypte et Afrique du Sud,
l'exploitation cinématographique est au plus bas en Afrique. Mais la relance annoncée par les multiplexes et la production de quelques oeuvres audacieuses pourraient bénéficier aux
films africains.