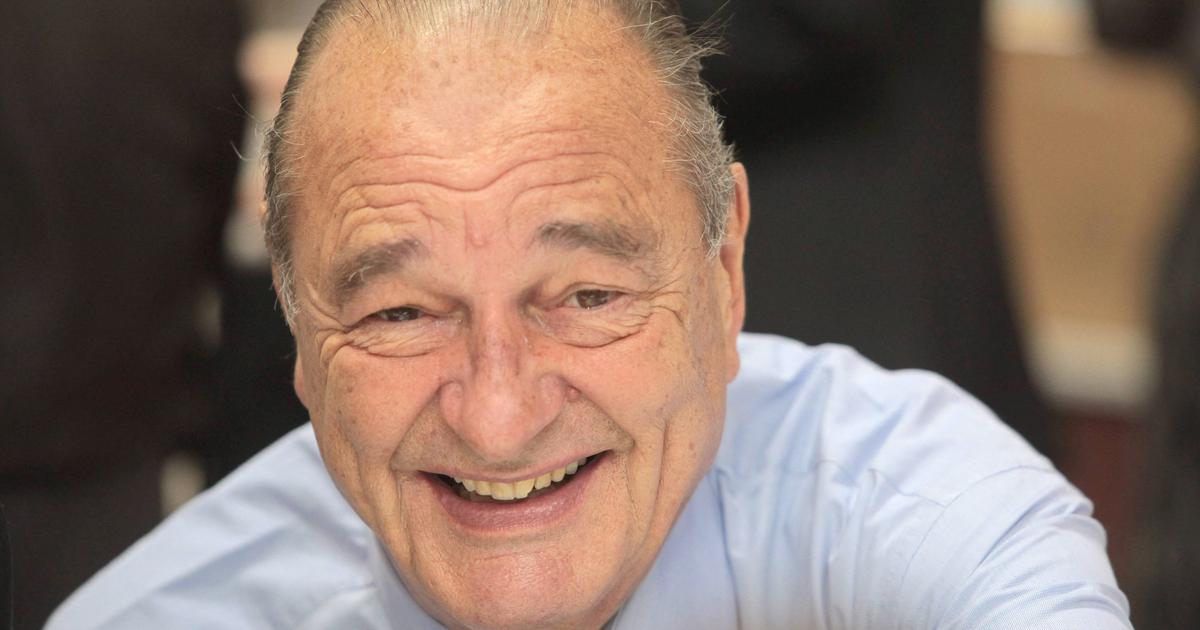- Select a language for the TTS:
- French Female
- French Male
- French Canadian Female
- French Canadian Male
- Language selected: (auto detect) - FR
Play all audios:
L'entraînement, organisé par l’association Expertises Climat, a lieu à l’Académie du climat.
Faire passer efficacement un message scientifique à destination du grand public, dans un contexte de climatoscepticisme : c’est tout le défi de ces spécialistes qui se forment lors de
media-trainings.
Il aurait suffi du traditionnel « dring » de la récréation pour nous sentir parfaitement à l’école. En plein centre de Paris, ce jeudi 6 mars, dans une pièce de l’Académie du climat aux
allures de salle de classe, Claire Peltier et Marion Calais, respectivement co-directrice en charge des médias et responsable éditoriale de l’association Expertises Climat, attendent trois
chercheurs.
Leur objectif : former ces scientifiques, spécialistes du climat, à la prise de parole dans les médias. Et les ajouter au réseau de l’association pour partager leurs contacts aux
journalistes en recherche d’experts.
Au menu de la matinée : présentation de l’écosystème médiatique. Étape d’autant plus incontournable qu’aucun des trois chercheurs ne possède de télévision. « Ils veulent être dans des
émissions qu’eux-mêmes ne regardent pas, parce qu’ils savent que le grand public regarde le petit écran et que ça permet de toucher des personnes de différents milieux, en zone urbaine comme
rurale », décrypte Claire Peltier. Début 2023, le Centre d'observation de la société rappelait que, en moyenne, 44 millions de Français regardent la télévision chaque jour.
Anne-Caroline Prévot est une habituée des podcasts et des interviews publiés dans la presse écrite. Pourtant, face à des journalistes, la chercheuse au Muséum national d’histoire naturelle
et directrice de recherches au CNRS reste stressée. La quarantaine passée, elle maîtrise les prises de parole en conférence, en cours, face à un amphithéâtre d’étudiants, mais dit manquer de
confiance en elle face à un micro ou une caméra. « Pourtant, je considère que j’ai des choses à raconter ! » sourit la scientifique qui s’intéresse par ailleurs aux impacts de l’absence de
nature sur nos comportements. Elle vient chercher des astuces pour préparer ses interventions.
C’est le but des exercices de mise en situation, organisés l’après-midi. Face à Marion Calais, ancienne journaliste sur RTL et Europe 1, les chercheurs ont un objectif : faire passer leur
message. Encore faut-il identifier le propos à transmettre.
Celui de Marion Bet : l’écologie concerne, au quotidien, chacun d’entre nous. Cheveux bruns en partie relevés en arrière et sourire communicatif, la docteure en philosophie et en sciences
sociales semble confiante et bienveillante. Chercheuse au sein du programme « Modes de vie en transition » à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri),
elle n’est pas là par hasard : « Mon objectif est d’avoir des principes de prise de parole, des règles que j’aurai en tête pour garantir mon impact lors d’interviews. »
Au fil des exercices, les chercheurs ne doivent pas perdre de vue leur message. Et pour s’assurer de sa bonne transmission, trois conseils sont donnés : utiliser à la fois « la tête, pour
l’aspect conceptuel et intellectuel du propos ; le cœur, en insérant le registre émotionnel et en développant une attitude empathique ; et le corps, en ayant une bonne gestuelle », explique
Marion Bet, attentive aux conseils de Marion Calais lors de la matinée théorique.
Aux manettes du media-training depuis son arrivée à Expertises Climat, Marion Calais a présenté journaux, podcasts et émissions pendant dix-huit ans avant de rejoindre l’association en
septembre 2024. « On parle aux chercheurs de l’importance de ramener leurs recherches à hauteur de chacun d’entre nous afin de parler au plus grand nombre. Ça passe par des exemples qui font
référence à des événements d’actualité comme les récentes inondations à Valence. Ils doivent être le plus concret possible. »
Après une dizaine de media-trainings, au rythme moyen de deux par mois, la responsable éditoriale a vu passer tous types de chercheurs. La plupart étaient déjà à l’aise avec l’exercice
d’interview pour de la presse écrite, mais moins avec la télévision et la radio, « qui imposent une quasi-perfection. On oublie que ce n’est pas naturel de se retrouver face à un micro ou
une caméra ! »
Pour entraîner les scientifiques, venus d’eux-mêmes ou contactés par Expertises Climat, Marion Calais se glisse de nouveau dans la peau d’une journaliste. Assise à l’une des tables de la
petite salle de classe de l’Académie du climat, elle installe un micro professionnel, un trépied et un iPhone face au scientifique. L’interview peut commencer. La vidéo est ensuite diffusée
sur l’écran face aux apprentis. Puis, place aux commentaires.
Avec, à chaque fois, la même question des deux formatrices : « As-tu fait passer ton message ? » Marion Bet acquiesce. Elle était à l’aise, a répondu aux questions de Marion Calais avec des
propos concernants : « L’écologie, c’est aussi notre quotidien, l’approvisionnement des ressources, le carburant, les emplois, etc. »
« Ce n’est pas naturel de se retrouver face à un micro ou une caméra »
Place ensuite au débrief d’Anne-Caroline Prévot. « Tu es comme un diesel », rigole avec bienveillance la journaliste. Sur l’écran diffusant l’interview, la chercheuse apparaît le dos droit,
les deux pieds au sol. Elle se concentre, écoute la première question concernant des milliards de dollars débloqués pour l’écologie lors de la COP 29. Elle réfléchit, hésite, tente,
marmonne, peste. À partir de la troisième question, elle expose ses idées de manière plus directe et affirmée. « Je t’ai reposé la première question à la fin et tu y as répondu avec
assurance cette fois-ci ! », constate l’ancienne journaliste. La scientifique doute de sa légitimité à répondre aux questions qui ne sont pas exactement dans son domaine d’expertise. « Tu as
le droit de dire que tu ne travailles pas là-dessus ou de ramener le sujet sur tes compétences en faisant une pirouette dans ta réponse », conseille Marion Calais.
Désormais, au quotidien, lorsqu’elle écoute les interviews, la journaliste est plus attentive aux réponses. Elle prend note des structures utilisées et des bonnes méthodes afin de les
présenter aux chercheurs en formation. L’exemple parfait selon elle : « Heidi Sevestre, une glaciologue régulièrement interrogée dans les médias qui réussit toujours à faire passer son
message. »
Aux côtés de Marion Bet et d’Anne-Caroline Prévot, Samy Kraiem présente un profil un peu différent. Ingénieur climatologue depuis six ans, il travaille pour Callendar, une start-up qui fait
de l’utilisation des données scientifiques une ressource pour les entreprises et les particuliers. D’apparence confiant, il a répondu aux questions posées avec, parfois, un sourire en coin.
Il n’est pas sûr d’avoir réussi à faire passer son message clé, « mais j’ai parlé de Callendar », rigole-t-il.
Lors des débriefs, tous s’interrogent sur la place à donner aux opinions. En tant que scientifiques, peuvent-ils parler de leurs émotions quand ils sont révoltés, indignés ? Peuvent-ils
parler d’eux-mêmes ? « Il n’y a pas de bonne réponse. Chacun peut faire comme il le sent. Les études d’opinions disent que les Français veulent des informations factuelles et c’est ça qu’ils
attendent de la part des chercheurs. Ce qui ne les empêche pas de mettre de l’émotion dans leurs propos, bien au contraire », répond Claire Peltier. Ancienne responsable des projets RSE du
groupe Le Monde, elle a par ailleurs participé à la mise en place de dispositifs de formations des journalistes aux enjeux environnementaux.
Dans la cour de l’Académie du climat, Samy Kraiem tire sur sa cigarette. La journée de formation tire à sa fin. Il a trouvé l’exercice « rigolo ». « Je me dis que les conséquences d’une
interview ratée sont assez négligeables. Mais je me forme, parce qu’une interview réussie peut avoir beaucoup d’impact. »
Déjà interviewé sur TF1, BFMTV et sur les ondes de certaines radios, le trentenaire était interrogé pour présenter son entreprise. « J’ai été lâché dans le grand bain sans formation. Ça
s’est bien passé, mais je me dis qu’il y a peut-être eu une part de chance et les interviews étaient assez courtes. […] Je sais qu’il me faut plus de billes si on me propose un exercice de
questions-réponses plus long par exemple. »
Désormais, le climatologue sait comment il devra préparer ses interventions. Il compare le journaliste à un collégien qu’il faut prendre par la main. « Au quotidien, j’ai plutôt l’habitude
d’échanger avec des personnes qui ont des connaissances scientifiques dans mon domaine. Dans le cadre d’interviews, ce n’est pas le cas. »
Il sait maintenant que la vulgarisation du propos passe aussi par l’utilisation de mots compréhensibles et concrets. Lui qui ne consomme ni radio, ni télévision, mais s’informe « sur
Internet, sur Twitter et Reddit, en lisant Le Monde diplomatique ou en visionnant Al Jazeera ou des lives de la chaîne LCP », a conscience que ses progrès passeront par de la pratique. « Je
sais qu’il ne faudra pas que je révise uniquement le jour de l’examen », rigole-t-il. Il espère être identifié par les médias comme climatologue, « parce qu’il y en a peu en France », et
peut-être, intégrer des groupes de travail.
Son aspiration ultime : « participer à une émission liée à la vulgarisation scientifique comme le programme de Jamy Gourmaud, par exemple. » Un clin d’œil à ses visionnages de « C’est pas
sorcier », « la seule émission que mes parents m’autorisaient à regarder ».
Selon le baromètre « Science et Société » publié fin 2024 par l’Ipsos, les Français font majoritairement confiance aux chercheurs pour trouver des solutions aux problèmes de notre époque. «
Le chercheur bénéficie d’une vraie crédibilité, le public leur accorde une certaine confiance », constate Marion Calais.
La crise du Covid-19 a mis en lumière un manque de diversité : les mêmes scientifiques étaient souvent interrogés. Dans le domaine climatique, Claire Peltier fait le même constat, « et on a
des médias qui nous contactent parce qu’ils souhaitent plus de parité en interrogeant aussi des chercheuses ».
Le dernier projet de l’association Expertises Climat consiste à développer le réseau de chercheurs en région, afin que les journalistes des médias locaux puissent obtenir des réponses sur
des problématiques spécifiques. « Il y a des spécificités sur le littoral méditerranéen qui sont différentes des zones montagneuses, de l’Ardèche, etc. », détaille Claire Peltier.
Face à un climatoscepticisme répandu dans la population (près d’un tiers selon l’Ademe), très actif sur X et accueilli avec complaisance sur certaines antennes (CNews, Sud Radio…), la
présence de chercheurs spécialistes du climat dans les médias a toute son importance. Pourtant, l’Observatoire des médias sur l’écologie a noté qu’en 2024, 3,7 % du temps d’antenne a été
consacré aux enjeux environnementaux dans les programmes d’information des médias audiovisuels français. C’est 30 % de moins qu’en 2023.
Pour faire face aux demandes des journalistes, apprendre à dire non, gérer leur communication sur les réseaux sociaux, un personnage clé pour les athlètes : l’attaché de presse. Son rôle se
fait d’autant plus crucial en cette année de JO.
Chacun de leurs livres crée l’événement. Voici comment la petite équipe des éditions Goutte d’or s’y prend.
Rythme de l’info continue, jeunisme, tempo pub... les médias de masse sont à la fois reflet et acteur du présent : sous la pression de la concurrence qui les assujettit au flux tendu, radios
et télés font émerger de nouveaux formats de voix en se faisant l’instrument de leur normalisation.